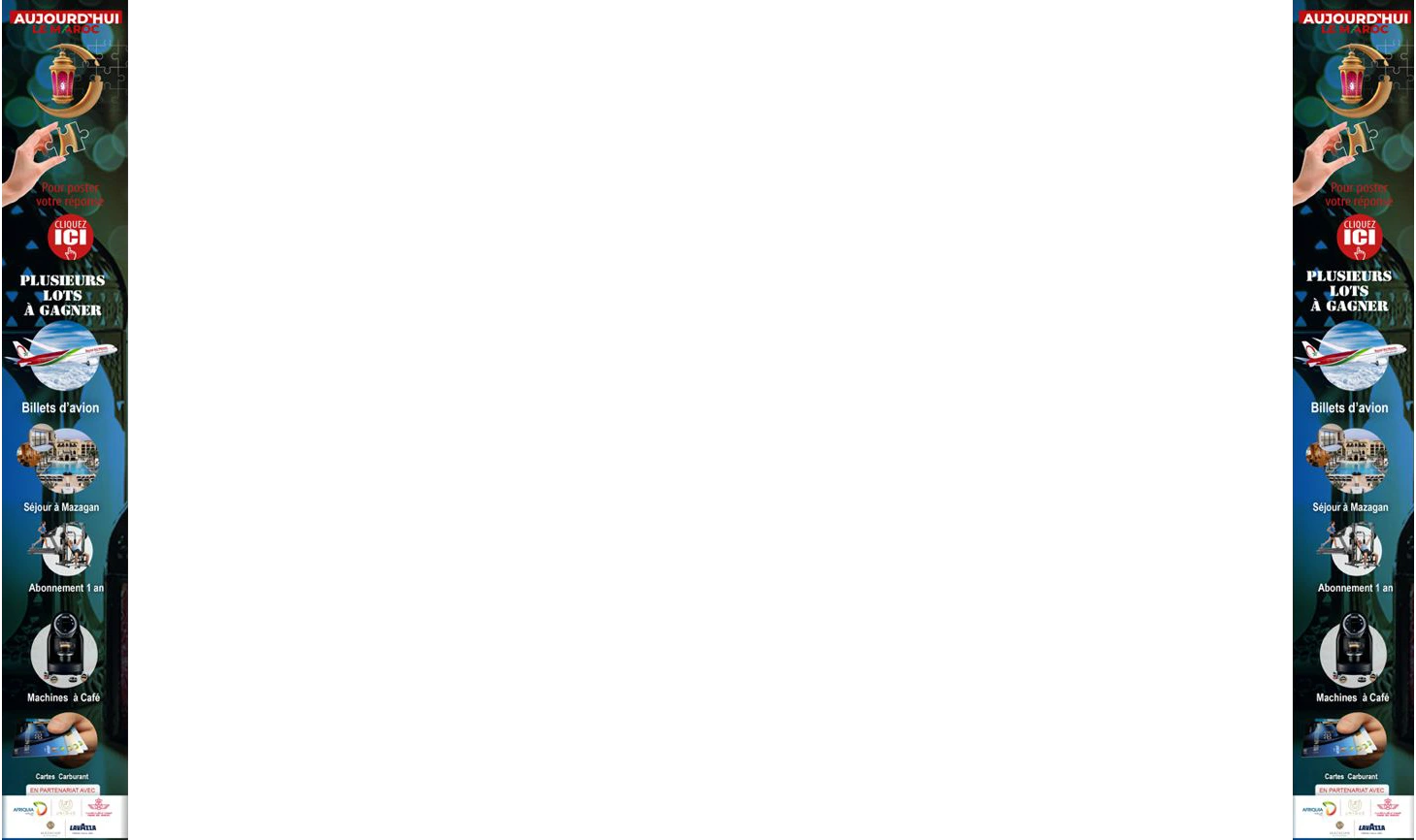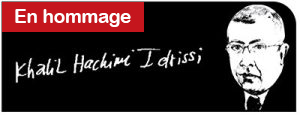C’est jour de matches. Au pluriel. Mais il ne concerne que deux équipes, le Wydad et le Raja. Un match qui commence par des préludes aux alentours du stade et se poursuit par des prolongations toujours dans la rue. Pendant que les deux équipes se mesuraient sur le terrain, leurs deux publics s’affrontaient dans la rue, s’attaquaient à tout ce qui bougeait sans distinction de race, de religion, de quartier ou de sexe. Score : 1 mort à zéro. C’est triste, c’est malheureux, mais c’est comme ça. Qui se souvient de la qualité du jeu, de son enjeu, de son résultat ? C’est un match nul dans tous les sens. Nul et non avenu. Inacceptable. Intolérable. Je vois d’ici les parents qui voient leurs enfants partir pour un match. Reviendra, reviendra pas. Le foot est désormais une fête qui se déroule sur un ring. Le phénomène est devenu assez récurrent pour que le pugilat ne soit pas signalé. C’est un état de belligérance d’autant plus chaotique qu’il oppose deux armées sans chefs.
On s’affronte, donc on est. On voit bien qu’il n’y a pas de jugeote là-dedans. J’utilise l’impersonnel parce que c’est la garantie présumée de l’anonymat dans les mouvements de foule qui donne cette lâche confirmation du soi en cassant des bus. Je n’aime pas les bus, à cause de leur irrespect des normes aussi bien de l’entretien que de la circulation, mais je n’aime pas non plus qu’on les casse. Pour les supporteurs comme pour les transporteurs, c’est la transgression des règles de conduite qui est ainsi érigée en mode de vie. Là où la foule donne aux premiers un sentiment d’impunité, la carrure des bus et un certain laxisme de la sécurité routière procurent aux hooligans de la conduite, une désinvolture insupportable. Au fait, les bus, combien de morts et de dégats par an?
Je ne cherche aucune excuse aux chauffards du foot. Bien au contraire. J’ai lu suffisamment d’épilogues sur les incidents de Casablanca pour que je n’en remette pas une couche. La périphérie du public et la centralité du stade, par exemple. C’est bien vrai, mais ça ne justifie rien. Un confrère a été même creuser dans la condition sociale du public en furie. Un peu court et trop facile. Non seulement ce n’est pas vrai pour tout le monde, mais la pauvreté n’est pas synonyme de violence. Ce qui est condamnable doit être condamné. Sans autres formes de procès ni quête de circonstances atténuantes.
La pauvreté. Qui mieux en a parlé que Mohamed Choukri. «Le pain nu» bien sûr, mais aussi, un ouvrage que je découvre grâce à un ami, «Le temps des erreurs»*. Du creux de son ventre il a sorti la beauté des mots, des misères de la vie la sublimation des instincts. Voilà ce qu’il disait: «Les hommes éclairés ont sombré dans la folie ou délirent dans les rues. Ceux qui devaient rester ont émigré […] le voyage a commencé bien avant qu’ils ne partent. Je les ai vu boire leur dernier verre. L’un d’eux a emporté avec lui un sachet de terre du pays. Une amulette. Servira-t-elle d’engrais aux graines de l’exil forcé ? Y plantera-t-il les racines de la menthe ? C’est le caprice de la misère de son pays. Les temps difficiles approchent», m’a dit Benites à Asilah. «Y en a-t-il eu des doux ?» ai-je demandé.
* édition Seuil