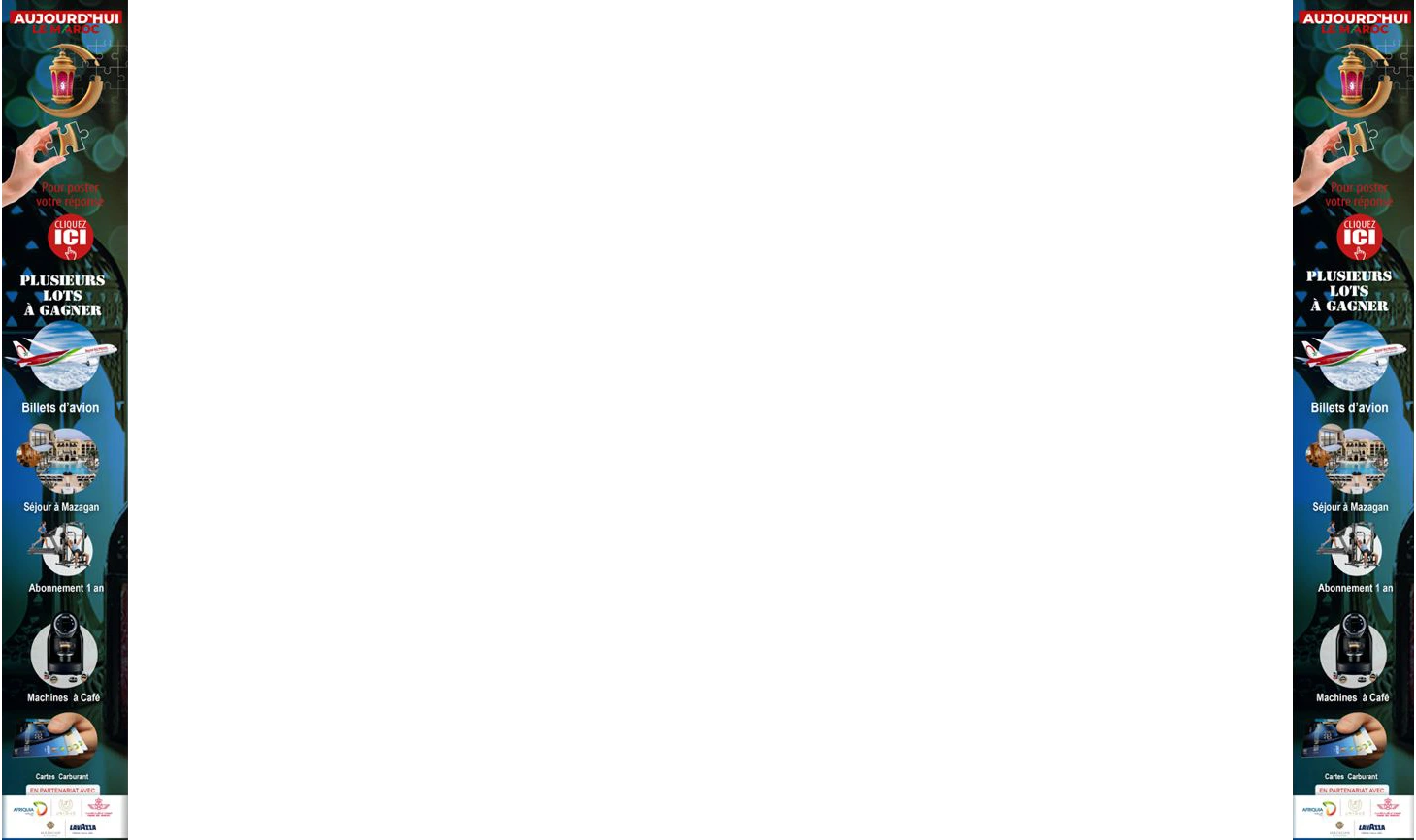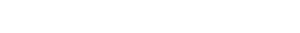L’échec du système éducatif ! On en parle depuis si longtemps que l’on est près de croire à l’incurabilité. Le mal était si profond déjà il y a une dizaine d’années que Feu Hassan II avait pratiquement délivré, en mars 1999, un certificat de décès à l’éducation nationale : «Le système éducatif actuel, conçu pour répondre aux nécessités urgentes, apparues au lendemain de l’indépendance, avait-il tranché, a épuisé son objet.» Son impératif devenait désormais «de bâtir un nouveau système éducatif à même de faire face aux défis du prochain siècle.» Le défunt Souverain en confia la charge à la Commission spéciale éducation Formation. Dès son avènement, Mohammed VI confirma la COSEF dans sa mission en faisant d’une réforme du système, «gérée de manière rigoureuse, centrée sur des objectifs déterminés», une priorité nationale juste après l’intégrité territoriale, tout en lui fixant un échéancier précis. Huit ans après la formation de la commission, force est de constater que l’on est encore loin du résultat escompté.
Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé. La COSEF a auditionné, disséqué, diagnostiqué, déduit… Elle a pu ainsi élaborer aux fins de la réforme une Charte nationale. Et on ne peut pas dire que les principes fondamentaux ainsi que les espaces de rénovations et leviers de changement qu’elle a déclinés manquaient de pertinence ou d’intentions louables. D’où cette question si simple et si vitale : pourquoi alors on en est encore là ? Il en découle une autre question : A quand remonte réellement le début de l’échec d’un enseignement qui, malgré ses imperfections, a pendant un temps fourni au Maroc ses meilleurs cadres et servi d’ascenseur social à des hommes comme Mohamed Hassad, aujourd’hui wali de Tanger, ou encore Abdelaziz Meziane Belfquih précisément animateur de la COSEF et actuellement président exécutif du Conseil supérieur de l’enseignement ? Par quelle catastrophe notre enseignement est-il devenu le producteur hors pair de l’illettrisme et de l’incompétence que l’on connaît ? Par quelle malédiction encore, d’outil de promotion il s’est mué en usine de fabrication de chômeurs ? Et par quel malheur, alors qu’on sait quoi faire et comment le faire, cet espace si vital est-il devenu irréformable? Plusieurs facteurs sont en jeu, mais un duo infernal va dans les années soixante-dix s’abattre sur le système éducatif du pays ; la marocanisation et l’arabisation. Elles constitueront le corps du délit qui va donner lieu, malgré lui, à toutes les déviances.
Enjeu de politicailleries intérieures*, l’arabisation ne peut être intrinsèquement incriminée. L’illogisme de sa mise en œuvre vient plutôt de la brutalité de l’ici et maintenant avec laquelle elle a été appliquée et de l’incompétence notoire de ses accoucheurs. La réussite de pareille reconversion supposait la préexistence de trois maîtrises chez le «convertisseur» : celle de la matière à convertir, celle de la langue d’origine de cette matière et celle de sa langue de réception. L’approche aurait dû en même temps œuvrer pour la consolidation de l’enseignement des langues de la recherche à savoir l’anglais et accessoirement, pour des raisons historiques, le français. Afin de réaliser un tel objectif, il suffisait à l’époque d’être capable de regarder sans préjugés comment faisaient les Israéliens pour l’hébraïsation de leur enseignement. En lieu et place, nous avons arabisé l’enseignement marocain comme on traduirait un acte notarial.
Comme un malheur n’arrive jamais seul, la mise en place d’une arabisation improvisée a été précédée par la marocanisation de l’enseignement. L’une comme l’autre répondaient naturellement à une revendication politique mal assimilée, mais la marocanisation était aussi forcée par le désengagement de la France qui avait entamé le rapatriement de ses coopérants, encouragée, semble-t-il à l’époque, par le FMI qui estimait le temps arrivé pour les pays récemment décolonisés de se prendre entièrement en charge. Et là où nous aurions dû négocier avec Paris un plan de substitution étalé dans le temps, nous nous sommes contentés de prendre acte du retrait français, pour certains d’entre nous imbécilement heureux et pas peu fiers d’avoir mis un terme à la présence française. Pour combler les postes vacants, nous allons tout simplement commettre un crime contre l’intelligence en prenant des jeunes fraîchement bacheliers, rebaptisés «chargés de cours» mais dépourvus de toute formation pédagogique pour peupler les classes désertées par la coopération française. Ce processus de bricolage atteindra son comble avec l’égyptianisation et la roumanisation du corps enseignant. Nous avons ainsi importé du pays du génie des Carpates des enseignants roumains qui ne connaissaient pas un traître mot de l’arabe, maîtrisaient très mal le français pour enseigner des matières scientifiques, les maths notamment, alors que nous n’avions d’ailleurs aucune idée sur leur degré de maîtrise de la matière. La descente aux enfers se poursuivra avec la création des Centres pédagogiques régionaux pour former au pied levé des enseignants pour le premier cycle puis le secondaire après la triste fermeture, pour des raisons plus politiques que pédagogiques, de l’Ecole normale supérieure. Avec beaucoup d’argent, le quart du budget national, et toute la bonne volonté du monde, nous avons réussi l’exploit de mettre en place un circuit implacable de reproduction de la sous-formation. Le système éducatif pouvait sombrer.
Les effets de ces choix ne pouvaient échapper à la vigilance ni du pouvoir ni de l’opposition. En témoignent les colloques, notamment celui de d’Ifrane (1980), et les différentes commissions dites nationales pour trouver des solutions à l’imbroglio. Avec les résultats que l’on sait. Deux facteurs ont été déterminants, de façon certes inégale, dans la déchéance de l’Education nationale. Un corps enseignant perméable aux idéologies – marxisantes à l’époque, islamisantes aujourd’hui- et l’absence de l’école unique, dans son ancienne acception, pour l’ensemble des Marocains. Jamal Berraoui (Aujourd’hui Le Maroc du 8 février) semble regretter l’effacement de l’engagement des années soixante des rangs des enseignants. Grand bien lui fasse ! Mais en dehors du couple arabisation – marocanisation et de la mission française (on verra pourquoi en rapport avec l’absence de l’école unique), rien n’a autant nui au système éducatif que cet engagement. Non seulement il s’est transformé à la longue en un corporatisme étriqué et égocentrique, plus préoccupé par les augmentations salariales et ses acquis sociaux que par les questions pédagogiques, mais encore il a pris l’Education nationale en otage du bras de fer entre le pouvoir et l’opposition. Très tôt, mais de façon plus patente avec les émeutes de mars 1965, celle-ci a pris la mesure de l’usage qu’elle pouvait faire de l’instrumentalisation des élèves, des instituteurs et des professeurs dans les rapports de force avec la Monarchie. Au lieu de rester un espace d’apprentissage, d’acquisition et d’épanouissement des idées, l’école marocaine s’est transformée à son insu en une arène de confrontation politique. Si fort et si bien que nous sommes l’un des rares pays dont le système éducatif a vécu une année blanche (1971) suite, sous le regard activement complice des enseignants, à une longue grève des élèves et des étudiants. Si fort et si bien encore qu’aucune réforme ne pouvait être sérieusement pensée et encore moins passer dans pareille ambiance.
L’absence de l’école unique, non pas dans ce sens où elle est perçue par opposition à l’école régionalisée, différenciée, adaptée à l’environnement social, économique et géographique de la population qu’elle veut servir, mais dans celui où l’école marocaine vivait dans un état dual, au sens économique du terme, avec l’école française, va contribuer à la relégation des problèmes de l’enseignement au second plan dans les préoccupations des décideurs. La présence de la mission française, rejointe plus tard par l’école américaine, a ainsi couvert d’un voile d’indifférence les problèmes dans lesquels pataugeait l’enseignement marocain. Le but n’est pas de reprendre à César ce qui lui appartient, mais devenu, sans le vouloir certainement, valeur refuge des enfants des décideurs et de la classe moyenne, la mission française a agi de telle manière que tous ceux qui pouvaient modifier le cours des choses, ne vivant pas le drame dans leur chair, se sont désintéressés du problème. A la longue, on pouvait même croire que l’existence de la mission avait fini par arranger tout ce que le Maroc comptait et compte de pesant dans la politique de l’Etat du fait qu’elle assurait la reproduction des élites en circuit fermé au sein d’une même classe sociale. Tout au plus celle-ci pouvait-elle ressentir face cette situation ce que l’on peut ressentir pour un voisin dans le malheur : de la compassion de circonstance.
Tout est noir dans le plus sombre des mondes ? Fort heureusement non. Des îlots de la bonne formation existent où survivent des enseignants qui ont d’autres soucis que les besoins de survivance. Dans l’enseignement supérieur, l’Ecole Mohammadia des ingénieurs, l’Institut national des postes et télécommunications, l’Ecole des sciences de l’information, l’Ecole des mines, l’Institut agronomique et vétérinaire, l’ISCAE ou encore l’INSEA constituent des bastions de la formation de qualité mais qui exigent des seize de moyenne pour participer aux concours y donnant accès. Et, malheureusement, souvent pour former des candidats à la fuite des cerveaux. Quand une école de la santé qui forme des infirmières et des infirmiers d’Etat candidats à l’échelle neuf exige une moyenne de quatorze, que reste-il à faire ? Réformer, bien sûr. Seulement voici vingt sept ans que nous faisons du surplace et jamais on n’a autant parlé de réformes qu’en ne réformant pas. Classe après classe, vague après vague, l’enseignement marocain a produit des générations de semi-lettrés pour un monde où le savoir a pris de nouvelles formes aussi denses qu’éphémères, nécessitant une perpétuelle remise en cause des acquis et des acquisitions. Quand un enseignement réussit le tour de force de produire des docteurs dont l’ambition se limite à servir dans l’administration publique sans comprendre que l’Etat ne pouvait indéfiniment grossir la bête, c’est qu’il leur a tout appris, notamment, forme suprême de la paresse, la culture du sit-in, sauf le goût du risque, sauf le sens de la curiosité mère des ingéniosités, sauf l’intelligence de comprendre qu’il y a mieux à gagner ailleurs, sauf la volonté d’investir les espaces sans cesse renouvelés de l’initiative et de la création. Sauf et sauf et encore sauf. Toute l’indigence de notre système se résume dans les manifestations de ces diplômés chômeurs, chômeurs professionnels devrions-nous dire désormais, qui contribuent à l’économie du pays en achetant du tissu pour fabriquer des banderoles.
Qui est responsable ? Nous tous, hélas! Les gouvernements qui se sont succédés sur le Maroc faisant en la matière preuve d’incurie. Les partis politiques qui ont fait de l’enseignement un outil de la course au pouvoir sans jamais avoir été capables de fournir le début d’une véritable solution. Les syndicats qui leur ont servi de levier, faisant du mélange des genres entre le syndicalisme corporatiste et le syndicalisme au service des stratégies partisanes une profession. Et nous encore, élèves de l’époque qui avons été les acteurs tristement joyeux de l’année blanche. En dépit de cette flagrance, aujourd’hui encore on cherche à mettre sur les responsabilités des visages et des noms, probablement pour mieux couper des têtes. A quoi bon ?! Quand comprendrions-nous enfin l’urgence de cesser de faire de l’enseignement l’objet de surenchères politiques et personnelles ? Que faire en lieu et place, sinon faire ce que fait le médecin devant une gangrène à un stade avancé : l’amputation. L’idée est si monstrueuse, et si elle ne l’est pas c’est qu’elle est farfelue ou simpliste, que j’hésite à la formuler. Pourtant je franchis le rubicon : et si tout le problème était une question d’approche. L’écheveau étant si entremêlé qu’on ne sait plus par quel bout le prendre, le plus judicieux ne serait-il pas aujourd’hui de revoir à la baisse l’ambition d’une réforme globale. Il s’agit ni plus ni moins que de réaliser que l’irréparable a été commis. Qu’en conséquence le seuil de l’irréversibilité, en raison de l’accumulation des dégradations dans la qualité de la formation, pour les générations en cours de scolarité, ayant été atteint, le Maroc serait mieux avisé de se rendre à l’évidence de l’incurabilité de la maladie. Il est loisible de voir d’ici les âmes chastes hurler au scandale, mais il y a toujours un temps où il faudrait se rendre compte que le mieux est l’ennemi du bien et que lorsqu’on n’a pas les moyens de sa politique il est toujours plus efficace de faire la politique de ses moyens. Un adage bien marocain dit : Que celui qui s’est égaré, cesse de tourner.
L’éducation est un droit, mais l’excellence est un «luxe» que ne peuvent pas se payer de façon équitable tous les élèves et étudiants marocains. Dans notre système éducatif, pour avoir il faut en avoir et seuls ceux qui ont généralement les aptitudes intellectuelles propres à la réussite arrivent à trouver une place au soleil. Les autres pataugent dans une formation qui ne les qualifie pas à grand-chose. Pour les premiers, le système doit trouver en lui les moyens de leur repérage, de leur encadrement et de leur orientation vers les grandes écoles et instituts nationaux qui ont sauvegardé un minimum de qualité. Il doit leur trouver également, avec la recrudescence des flux migratoires vers les pays du Nord, les moyens de les retenir. Pour les seconds, recadrer leur formation, sans trop d’ambition pour le moment, en considérant qu’on aura fait l’essentiel si on les sort de l’analphabétisme, si on réussit à leur donner les moyens de comprendre leur monde et de s’insérer plus ou moins facilement dans leur environnement. Il y a ainsi dans l’histoire des pays des générations sacrifiées. La réforme de l’enseignement doit se concevoir comme un chantier de construction programmé pour commencer avec le terrassement un jour J et se terminer avec la pose de la dernière dalle de couverture à une date prévue. Celle-ci serait appelée à marquer un cursus scolaire et universitaire arrivé à son terme ultime. Autant dire que la réforme du système éducatif national ne peut atteindre ses effets et s’appliquer dans toute sa rigueur que sur une durée minimum de vingt à vingt cinq ans. Inutile donc d’essayer d’allumer une cheminée avec du bois trempé. Dans le corps de l’enseignement il y a tout le sang «contaminé» à renouveler. En aval du système, le Maroc devrait entreprendre dès aujourd’hui la formation des premiers commandos de la réforme qui iront en amont, les premières années du primaire en l’occurrence, entreprendre la requalification de notre enseignement de telle manière que la qualité puisse se substituer progressivement à la médiocrité qui s’est installée dans le système éducatif suite à la sous-formation des quatre dernières décennies. Encore faudrait-il, dans un domaine qui a toujours invité à l’adhésion de tous, rompre avec la politique du consensus qui a tant bloqué les différentes tentatives de réforme. Plus facile à dire qu’à faire. Il faudra pourtant y passer…
* Cf. Abdellah Laroui, Le Maroc et Hassan II, P 61 à 64, éd. Presse Inter Universitaire