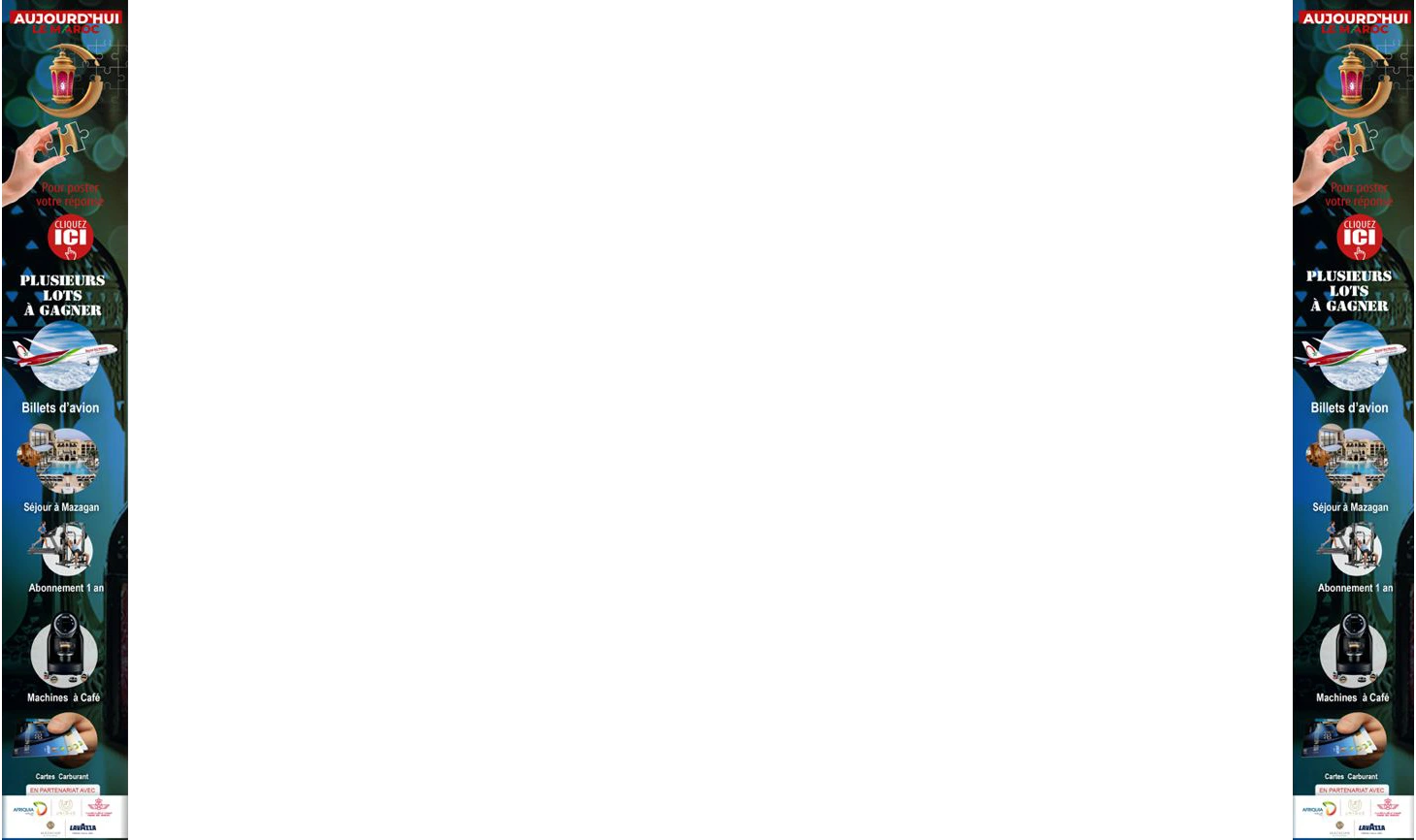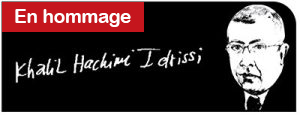On pourrait en dire autant des espoirs mis dans la justice internationale comme moyen d’imposer le droit dans le monde, dont l’effet est la création d’un Tribunal pénal international pour juger les ressortissants yougoslaves ou rwandais, ou encore le projet d’une Cour pénale internationale, destinée à fonctionner en permanence. Les bonnes intentions de ces initiatives sont incontestables ; leurs conséquences ne le sont pas toujours. Car dans cette situation de deux choses l’une. Ou bien on sacrifie l’efficacité à l’équité. Mais dans ce cas, la justice pour laquelle on se bat s’arrête à la porte des grandes puissances, c’est-à-dire, dans notre monde, non seulement les Etats-Unis mais aussi la Russie, la Chine, l’Inde et quelques autres. Raymond Aron écrivait à juste titre : « Un Grand n’accepte pas d’ordre et ne se laisse pas contraindre. » (Paix et guerre entre les nations, p.721.) Le processus d’instauration de la Cour pénale internationale (C.P.I) était révélateur à cet égard. Sept pays ont voté contre sa création : Etats-Unis, Inde, Chine, Vietnam, Israël, Bahreïn, Qatar. Il est permis de penser que si la Russie a voté pour, cela ne prouve pas qu’elle se soumettrait aux injonctions de la Cour. Le nouveau président américain a déclaré, aussitôt élu, qu’il ne ratifierait jamais la convention légalisant la Cour. Mais aurait-il signé l’accord en question, que le résultat problématique : les Etats-Unis ne se plient jamais aux exigences que leur adressent diverses Commissions internationales, seraient-elles créées par l’ONU, lorsque ces exigences concernent leurs activités en Amérique latine, ou plus simplement leurs intérêts. Ou bien, on sacrifie l’équité à l’efficacité. Dans ce cas, on enrôle au service de la justice une armée puissante – celle de l’OTAN, celle des Etats-Unis – mais avec le risque de voir cette armée servir ses propres intérêts plutôt que ceux de la justice. Louise Arbour, ex-procureur de la C.P.I, remarquait ingénument : « Les militaires peuvent difficilement renoncer au prisme des Etats nationaux pour percevoir leurs opérations. » (Le Monde des débats, le 25 mai 2001.) Ce qui ne l’a pas empêchée de faire appel à ces militaires, sinon de se mettre à leur service, en donnant une caution juridique à l’action de l’OTAN en Yougoslavie. Comment, ensuite, garder son impartialité ? On sait de quelle manière a été traitée l’accusation de crimes de guerre commis par l’OTAN : le Tribunal s’est contenté de confier l’enquête sur sa possible partialité à ses propres fonctionnaires – lesquels, sans surprise, ont classé l’affaire, en se déclarant eux-mêmes au-dessus de tout soupçon. Telle n’a pas été l’opinion de certaines ONG, ni du Comité international de la Croix-Rouge, pourtant peu suspect de sympathies pour Miloservic, qui déclarait dans son rapport sur cette question : « Une telle différence dans l’approche suivant que les crimes de guerre allégués sont imputables à la Yougoslavie ou à l’OTAN est effectivement choquante. » (Cf. P. Hazan, La Justice face à la guerre, p.219). La justice sélective, celle qui ne frappe que nos ennemis, est-elle encore de la justice ? On pourrait poser cette question non seulement en comparant le traitement différent réservé à la Yougoslavie et à l’OTAN au moment du conflit dans les Balkans, mais ailleurs aussi. Pensons par exemple à la politique à l’égard des minorités : celle de la Yougoslavie était certes critiquable, mais ne pouvait-on pas en dire autant de celle qui est pratiquée en Israël ou en Turquie ? Ces pays-là n’acceptent pas davantage que la Yougoslavie l’intervention internationale, sans même parler de la justice ; or ils n’ont jamais été pénalisés. L’explication ? C’est que ce sont des pays « amis », des pays stratégiquement utiles pour « nous ». Une réalité qu’on ne doit certes pas ignorer – mais qui n’a plus rien à voir avec la justice. Rêver à une justice universelle qui supplante celle des peuples ne cesse de poser des problèmes. C’est que, si la décision judiciaire est internationale, la communauté qui en subit les conséquences est, elle, seulement nationale. Imaginons qu’un gouvernement ait déclaré l’amnistie à propos d’une guerre civile passée, alors que la justice internationale décide que les crimes qui y ont été commis sont imprescriptibles et doivent être jugés. Faut-il obéir, au risque d’allumer une nouvelle guerre civile – dont seule souffrira la population du pays, non les juges internationaux ? N’est-ce pas au Chili de décider s’il faut juger Pinochet ? Au Cambodge, s’il faut faire le procès des complices de Pol Pot ? Car si ce n’est pas au nom du peuple, au nom de qui ou de quoi exercerait-on la justice ? Aujourd’hui, plutôt que d’établir un tribunal condamnant Milosevic, Pinochet ou Saddam Hussein, je me demande s’il n’y aurait pas plus de franchise à les exiler directement sur l’île Sainte-Hélène… L’essentiel n’est-il pas de les rendre inoffensifs ? Juger le dictateur après qu’il a perdu le pouvoir revient forcément à lui faire un procès politique ayant pour but de purger et rectifier le passé, transformant l’erreur stratégique en crime légal. Le dictateur déchu n’est pas seulement vaincu, il est de plus coupable. Pour éviter de transformer l’exercice de la justice en règlement de comptes politique, mieux vaut s’en tenir aux lois en vigueur et ne pas recourir à des principes religieux ou moraux qui seraient absents du code légal. Tous ces constats sur les carences des institutions internationales ne devraient pas nous inciter à les saboter un peu plus encore (le contrat est toujours préférable au chaos ou au chantage) ; en revanche, ils devraient tempérer notre enthousiasme. L’ONU peut être utile dans toutes sortes de situations ; simplement, face à la guerre, elle sera toujours soumise à la volonté des Etats hégémoniques. La justice internationale peut renforcer le règne de la loi, surtout si elle régit effectivement les rapports entre nations plutôt que de se bercer d’illusions mondiales. Mais, l’humanité étant ce qu’elle est, l’ordre international ne saurait remplacer la volonté des Etats et donc la puissance militaire. Les Nations unies ne suffiront jamais pour empêcher les agressions, assurer la paix, imposer la justice ; pour cela, la force est nécessaire, or la force appartient aux Etats. Il est donc vain d’opposer le droit à la force : sans la force, constatait déjà mélancoliquement Pascal, le droit est impuissant. Comment assurer la paix dans le monde ? Certains (la France) répondent : en faisant confiance au droit international et aux organismes comme l’ONU. Malheureusement, cette solution est défectueuse : on sait bien que les rapports internationaux n’obéissent pas au droit, à moins que les pays ne choisissent volontairement de s’y soumettre. D’autres (les Etats-Unis) répondent : en faisant confiance à notre force, la plus grande du monde. Tous les autres pays n’ont qu’à se soumettre et suivre cette politique, même quand elle leur déplaît : c’est le prix à payer pour le bénéfice de la paix. Sommes-nous condamnés à cette alternative ? Non : la « paix par la loi » et la « paix par l’empire » n’épuisent pas toutes les voies possibles. Ces deux réponses ont en commun de chercher le salut dans l’unité : unité bien réelle de l’empire américain, pour les uns ; unité rêvée du gouvernement mondial, pour les autres. A ces deux options, il faut ajouter celle de la pluralité, qui contribue au maintien de la paix par l’équilibre entre plusieurs puissances. C’est dans ce cadre que pourrait trouver sa place l’Europe de demain.
Une puissance tranquille
Dans le monde actuel, aucun pays européen ne dispose d’une force suffisante pour assurer seul sa défense contre une grande puissance ; encore moins pour peser sur le cours du monde. La France vient d’en faire l’expérience : au cours du conflit irakien, elle a défendu une position qui a suscité des sympathies mais n’avait aucune chance de s’imposer. Ses moyens militaires n’étaient pas à la hauteur de ses ambitions politiques. Aujourd’hui, chaque pays européen possède une armée qui reste sous contrôle national : une force réelle mais insuffisante si l’on se situe dans un cadre mondial. Or, de son côté, l’Union européenne n’a pas de politique de défense commune, ni d’armée à sa disposition. Les raisons de cette situation sont bien connues : au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le danger militaire pour l’Europe se nommait URSS ; cependant, les pays européens n’étaient pas de taille pour se défendre contre un tel adversaire. Il a donc fallu créer l’Alliance atlantique, avec l’OTAN comme force militaire : comme aux Européens et aux Américains, mais dominée par ces derniers. Au cours des décennies suivantes, les Européens ont donc profité du bouclier américain, sans avoir à le prendre en charge. La situation ne s’est transformée qu’en 1989-1991, avec la chute du Mur de Berlin et la décomposition de l’URSS : puisque l’ennemi dont on devrait se défendre n’était plus là, la politique de défense commune demandait à être repensée – mais elle ne l’a pas été. L’OTAN existe toujours, mais on ne sait plus à quoi elle sert ; et de toutes les façons, elle n’est pas dirigée par l’Europe.
- Accueil
- Actualité
- Politique
- Société
- Economie
- Culture
- Sports
- Faits-Divers
- Lifestyle
- Auto
- Emploi
- Médias
Copyright © 2022 Aujourd'hui le maroc Conception et développement SG2I Consulting
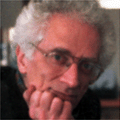
© D.R
Articles similaires
ActualitéSpécialUne
«Connexion haut débit» entre le Royaume et l’Afrique de l’Ouest
Grâce à son infrastructure robuste, Maroc Telecom a stabilisé la connectivité de...
Paralm29 mars 2024
SpécialUne
OCP, un engagement vert pour l’Afrique
Le leader mondial de la production et de l’exportation des phosphates était...
Paralm29 mars 2024
SpécialUne
Gazoduc Nigeria-Maroc, un chantier qui métamorphosera l’Afrique
Considéré comme l’un des projets stratégiques lancés au niveau du continent africain,...
Paralm29 mars 2024
ActualitéSpécial
Gitex Africa Morocco, le Maroc comme locomotive du numérique en Afrique
Participation de 130 pays à cette manifestation qui vise à favoriser les...
ParALM29 mars 2024