Votre panier est vide.
- Accueil
- Actualité
- Politique
- Société
- Economie
- Culture
- Sports
- Faits-Divers
- Lifestyle
- Auto
- Emploi
- Médias
Copyright © 2022 Aujourd'hui le maroc Conception et développement SG2I Consulting
ActualitéUne
Les fondements historiques de la pratique d’autonomie au Maroc précolonial : Cas du Sahara marocain (2/2)
ALM25 avril 2025

© D.R
Sa Majesté le Roi Mohammed VI à son arrivée à Laâyoune en février 2016.
Legs historique : Les Alaouites, sahariens de Tafilalet, descendants du Prophète Sidna Mohamed, ont consacré l’itinérance du pouvoir comme instrument privilégié de l’exercice direct de la souveraineté sur les régions frontalières et stratégiques, notamment la région du Sahara.

5. Les Saâdiens, centralité de la région du Sahara au sein de l’Empire Chérifien
Les Saâdiens, des Chérifiens originaires de Oued Drâa, ont propulsé la région du Sahara au cœur de l’Etat et de l’économie marocains en la plaçant en tant que colonne vertébrale des routes du commerce transsaharien, à l’aune de la réhabilitation de l’axe nord-sud ibéro-africain hérité des Almoravides, mais délaissé au profit de l’axe ouest-est maghrébin durant la période almohade et mérinide.
Les Mahallas des Sultans saâdiens dans la région du Sahara
Les Saâdiens se sont appliqués à exercer, directement et effectivement, leur souveraineté sur les provinces du Sud, en s’appuyant sur la pratique du pouvoir itinérant.
A peine investi Sultan, Moulay Mohamed Cheikh, jusque-là Gouverneur de Sous et du Sous Extrême, entreprend, en l’an 1566, une Mahalla aux provinces du Sud qui l’a amené à Haouza (Province de Smara), aux confins de Oued Sakia Al Hamra «Acequia el Hamara» ; expédition à laquelle a pris part le Voyageur – Historien espagnol Marmol Carvajal (1524-1600), qui s’y étale dans le prologue dans son ouvrage «Description de l’Afrique».
Dans cette même localité de Haouza, près de Smara, le Sultan Moulay Ahmed Al-Mansour Eddahabi concède une audience, auréolée de prestige dans la tradition saharo-hassanie, avec Sid Ahmed Rgueibi, éponyme des Rgueibat ; premier contact direct, entre le Sultan et un chef de tribu du Sahara marocain, et qui se pérennise, depuis, à l’ensemble des tribus sahariennes. 17
Le Sahara marocain, important contingent militaire dans l’armée saâdienne
L’historien Andrzej Dziubinski affirme que «les Saadiens attachaient la plus grande importance aux Provinces du Sud. C’était le berceau traditionnel de tous les prétendants au pouvoir et les Saadiens n’oubliaient pas leur origine. C’est pourquoi les oasis du sud de l’Atlas et du Sahara ont eu les garnisons les plus fortes.» 18
Selon Dziubinski, l’effectif de l’armée saâdienne de 63.500 hommes est réparti comme suit : «15.000 fournis par la région de Sous et la vallée du Draa (y compris le Sahara marocain), 25.000 par Marrakech et ses dépendances, 20 .000 par la région de Fès, et une légion étrangère de 3.500 fusiliers. Les tribus sahariennes (Rehamna, Oudaya, Oulad Dlim, Brâbisch … des Beni Hassan) forment la cavalerie lourde.»
Le nombre des régions, durant le règne du Sultan Moulay Ahmed Al-Mansour, est de neuf : «Sous et Sous Extrême (Sahara marocain), Fès, Tafilalet, Marrakech, Tadla, Drâa, Al-Fahs, Touat-Tigueurarine.» . Ces régions sont divisées en plusieurs communes urbaines et rurales. Toutefois, les villes stratégiques, frontalières ou côtières, bénéficient d’un statut juridique particulier et sont directement gouvernées par le Sultan.
Le Gouvernorat de Fès est généralement confié au Prince héritier, arborant le titre de Khalifa de Fès, alors les autres Provinces, notamment Marrakech, n’étaient pas toujours confié à des membres de la famille royale. Les Gouverneurs accomplissent une mission à la fois administrative et militaire.
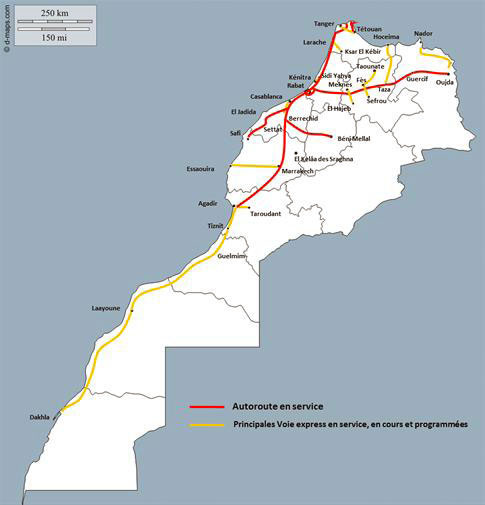
6. Les Alaouites, attachement indéfectible à la marocanité du Sahara
Les Alaouites, sahariens de Tafilalet, descendants du Prophète Sidna Mohamed, ont consacré l’itinérance du pouvoir comme instrument privilégié de l’exercice direct de la souveraineté sur les régions frontalières et stratégiques, notamment la région du Sahara. Le proverbe dicte que «le trône de l’Empereur du Maroc, c’est son cheval ; son baldaquin, c’est le ciel».
Dans ces provinces, lointaines et peu productives, le Sultan Alaouite est représenté par des Caïds ou des shaykh de Zāwiya, qui les administrent pour le compte du Souverain et y jouissent d’ «une large autonomie», comme ce fut le cas au Sahara.
«Pouvoir Itinérant», instrument d’administration des Provinces sahariennes
Le Sultan Moulay Ismaïl (1672-1727) n’est pas demeuré une année entière dans son Palais durant ses premières vingt-cinq de règne, alors que Moulay Hassan I (1873-1894) a mené dix-neuf Mahallas.
Le Sultan Moulay Ismaïl arbore le titre d’Empereur des deux Royaumes, le Royaume de Fès, Tafilalet et Marrakech, ainsi que le Royaume des deux Sahara (Sahara occidental et Sahara oriental). Il a nommé son fils Moulay El Mamoun comme Khalifa des Provinces du Sud.19
Le captif Thomas Pellow, chef du «Contingent militaire d’étrangers – Renégats -», sous le règne du Sultan Moulay Ismaïl, indique qu’il a campé, entre 1731 – 1732, dans l’une des multiples Mahallas sultaniennes, à «Oued Noun et à Oued Es-Seguiet el-Hamra», et qu’une caravane militaire ismaïlienne traverse annuellement le Sahara marocain, en route vers le pays des Chenguit (Mauritanie).18
Le Sultan Mohammad III (1757-1790) a administré directement les pays céréaliers et d’arboricultures, le Haouz, le Dir et le Gharb, et indirectement, les pays montagneux et désertiques, par l’intermédiaire de grands kā˒id [chefs de kabīla] et shaykh de zāwiya [maîtres de confréries religieuses].20
Résistance à la colonisation du Sahara, l’avant-garde de préservation de la souveraineté nationale
Dernier Grand Sultan du Maroc pré-colonial, selon l’expression de Jean-Louis Miège, Moulay Hassan I a œuvré, sans relâche, pour la sauvegarde de l’intégrité territoriale de l’Empire Chérifien.
Dans un contexte d’intensification des pressions coloniales sur le seul pays du Maghreb et du Machrek qui est resté maître de son intégrité territoriale, le Sultan Moulay Hassan I a multiplié, durant ses 21 ans de règne, les Mahallas et Harkas dans le sud du Maroc.
Il a nommé, durant sa Mahalla de 1882, Lhoussaine Ouhachem, Caïd des Provinces du sud et, durant celle de 1886, plusieurs autres Caïds et Bachas, notamment Mohamed Ben Lahbid Tidrari, Caïd des Ouled Tidrarin.
D’ailleurs, le Sultan Moulay Hassan I a nommé deux «lieutenants» au Sahara : Le Prince Moulay Rachid, avec résidence à Sijilmassa, pour gouverner le Sahara oriental, alors que le deuxième «lieutenant chérifien», Installé à Marrakech, est responsable du Sous et de la Sakia Al Hamra.
Au moment où le fait accompli colonial atteint son paroxysme, les Sultans Alaouites se sont attachés à la préservation de la souveraineté nationale et de la continuité de l’appareil de l’Etat au niveau local, même dans les contrées les plus reculées du Sahara marocain.
Le Sultan Moulay Abdelaziz a nommé, en 1896, Mohamed el Amin, Caïd des tribus d’Aït Lahssen et Yaggout, Brahim Ben Bahrek Chtouki, Caïd des Tekna et, en 1906, Slimane el Aroussi Caïd d’El Gourrah d’Izerguiyine.
Le Sultan Moulay Abdelhafid a nommé, par Dahir, en 1909, Habib Ben Beyrouk, Caïd des tribus Aït Moussa Ou’ali, Regueibat et Ouled Tidrarin.
Chantier stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Sahara au cœur de la gouvernance territoriale
Le chantier majeur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, d’approfondir le processus de la gouvernance territoriale et de le corréler au programme de développement économique puise ses racines dans ce patrimoine marocain millénaire.
Faire positionner les provinces du Sud à l’avant-garde dans les différentes échéances de mise en œuvre de la régionalisation avancée, consacrée dans la Constitution de 2011, participe de la Haute sollicitude que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, accorde aux populations sahariennes, à l’aune de la particularité des liens souverains de la Bayaâ et de la centralité du Sahara dans l’Etat-Nation marocain.
Dans le même temps, le Nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par l’Auguste Souverain en 2015, pour un montant d’investissement de plus de 80 milliards de dirhams, comportant un ensemble d’infrastructures de dimension continentale, reflète la détermination royale de faire du Sahara marocain une plateforme de connexion avec l’Afrique sahélienne et subsaharienne.
L’Initiative marocaine d’autonomie dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son unité nationale, présentée au Conseil de sécurité de l’ONU, le 11 avril 2007, en vue de clore définitivement le différend régional, créé artificiellement, il y a cinquante ans déjà, autour de l’intégrité territoriale du Royaume, est en harmonie avec ce legs historique marocain.
La dynamique inexorable que connaît l’appui international à la marocanité du Sahara et à l’Initiative d’autonomie conforte la justesse de la position du Royaume.
Les États-Unis, l’Espagne et la France, les puissances les plus impliquées dans la gestion onusienne de ce différend régional artificiel, reconnaissent la marocanité du Sahara et appuient le plan d’autonomie. Dressant le bilan diplomatique de l’année 2024, le ministre des affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a relevé que «113 pays à l’échelle internationale ont apporté leur appui à ce plan (d’autonomie). Le nombre de consulats généraux à Laâyoune et à Dakhla s’élève à 30, et plus de 27 pays africains ont ouvert des représentations diplomatiques dans les villes de Dakhla et Laâyoune, soit près de 40% des pays de l’Union africaine».
C’est le titre de la boite
Références
17. محمد نبيل ملين، السلطان الشريف الجذور الدينية والسياسية للدولة المخزنية في المغرب. 446 ص. 2013
18. La lettre de nomination, datée du 09 novembre 1692, du Prince El Mamoun en tant que Khalifa des Provinces du sud est conservée dans les Archives royales,. (Bahija Simou, Sahara Marocain dans les Archives Royales)
19. Thomas Pellow. The history of the long captivity and adventures of Thomas Pellow in South Barbary, Londres, 1743.
20. Abdallah Laroui. Le Maroc du début du XIXe siècle à 1880, in Histoire générale de l’Afrique, VI : L’Afrique du XIXe siècle jusque vers les années 1880, 6, p. 478-496.
Related Articles
ActualitéUne
Alerte météo : Averses orageuses avec grêle locale et rafales de vent, vendredi
Des averses orageuses avec grêle locale et des rafales de vent sont...
By ALM25 avril 2025
CultureUneVidéos
Vidéo. Comediablanca: une 2ème édition prometteuse
Le jeudi 24 avril s’est tenue la conférence de presse officielle de...
By ALM25 avril 2025
ActualitéUne
Service militaire 2025: l’opération de recensement du 25 avril au 23 juin
Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême...
By ALM25 avril 2025
EntretienSociétéUne
Entretien avec Racha Haroun Fadel, représentante et directrice du programme Protect ED au Maroc :Pour apporter à chaque enfant l’éducation à la sécurité dont il a besoin aujourd’hui…
Pour assurer la sécurité des jeunes et moins jeunes dans les établissements,...
By Dounia Essabban25 avril 2025















