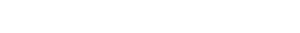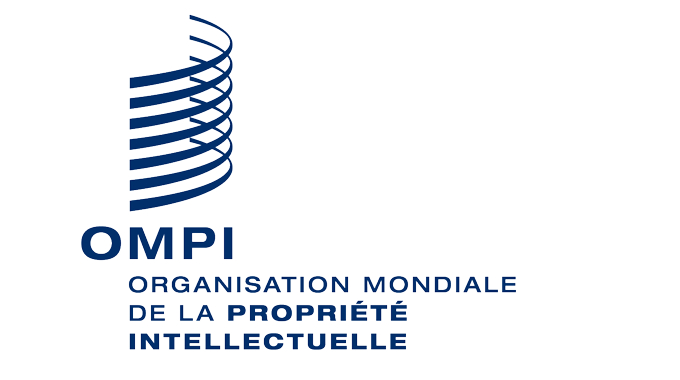Les bibliothèques publiques au Maroc : hier et aujourd’hui. Tel est, à juste titre, le titre d’une étude parue dans la Revue de la science de l’information, éditée par l’Ecole des sciences de l’information de Rabat. Une étude élaborée par le Pr. Mohamed Idsalah et tourne autour de trois phases historiques qui en disent long sur le recul enregistré en la matière. La première phase est relative à la genèse et l’évolution des bibliothèques publiques durant la période s’étendant du IXème siècle, date de la création de la première dynastie musulmane au Maroc jusqu’à l’établissement du protectorat en 1912. Une période durant laquelle les médersas, les mosquées et les zaouias étaient les dépositaires et les vecteurs du savoir et de la connaissance. Si ces institutions jouaient un rôle culturel, social et éducatif important analogue à celui des écoles, des universités et des bibliothèques publiques d’aujourd’hui, leur convergence à d’autres facteurs a favorisé la naissance et le développement des bibliothèques. Il s’agit en premier de la multiplication des centres d’enseignement, initiée par la fondation de la mosquée Qarawiyine à Fès en 859. L’enseignement n’était pas seulement dispensé dans les médersas citadines mais également dans les campagnes par l’intermédiaire des Zaouias, qui disposaient également de fonds documentaires. Durant l’époque pré-coloniale, l’encouragement et la protection des belles-lettres était de mise. Les ouvrages étaient collectionnés avec ardeur et servaient à alimenter les fonds des bibliothèques des médersas, fondations pieuses, Zaouias et bibliothèques privées.
L’introduction dès le XIème siècle du papier a favorisé l’essor de la librairie dans les villes, notamment à Fès et à Marrakech.
Bien que tardive (1865 à Fès), l’introduction de l’imprimerie jouera un rôle important dans l’édition d’ouvrages de base (manuels).
Ces facteurs combinés ont participé à constituer des fonds d’origines diverses (dons, transcriptions dans les ateliers de copistes, l’importation de manuscrits d’Orient). Ces fonds étaient essentiellement constitués d’ouvrages de théologie et sciences connexes, mais aussi de médecine, astrologie, géographie, littérature…). Qu’elles soient privées ou publiques, toutes les bibliothèques sont ouvertes au public des étudiants et des savants. L’instauration du protectorat va perturber cette évolution endogène.
Le protectorat n’en sera pas moins à l’origine de la création de nouvelles structures documentaires, entraînant ainsi la juxtaposition de deux modèles documentaires dualistes : le moderne, européen, et le traditionnel, indigène. Régies par des normes réglementaires (le dahir du 1er novembre 1926 et celui 27 janvier 1931) et alimentées par une recherche scientifique active, ces nouvelles structures constitueront les premiers jalons d’une politique dans le domaine des bibliothèques publiques. Une infrastructure, constituée de deux bibliothèques publiques générales et d’une série de bibliothèques publiques européennes et « indigènes » a vu le jour, soutenue et complétée par des mesures de promotion de la lecture en milieu rural.
Un effort sacrifié dès le lendemain de l’indépendance sur l’autel de priorités jugées plus importantes et plus urgentes. Un sacrifice qui perdure à nos jours.
Insuffisance des structures, manque de personnel compétent, indigence des fonds caractérisée par la prédominance d’ouvrages en langues étrangères, anarchie complète au niveau du catalogage collectif d’ouvrages et de périodiques.
Des maux relevés dès 1959 et qui continuent à nos jours. Le tout est marqué par l’absence d’une politique de bibliothèques publiques. Le nombre de bibliothèques publiques rattachées au ministère de la Culture ne dépasse pas 145, soit une bibliothèque pour 200 000 habitants. Ceci, sachant que le nombre d’utilisateurs de ces bibliothèques s’élève à 1 067 000 par an. Au niveau des ressources financières, le budget alloué en 2001 à ces bibliothèques n’a été que de l’ordre de 5 millions DH en termes d’équipements et 6 millions DH en matière d’acquisition.
En 1994, l’effectif global du personnel des bibliothèques relevant du ministère de la Culture est de 407 agents.
Le personnel professionnel n’en représente que 2,5%. Des chiffres qui en disent long sur la situation de la lecture et de la recherche dans notre pays.
Pays où le pouvoir d’achat, doublé d’un honteux taux d’analphabétisme, place l’acte d’achat d’ouvrage dans le rang du luxe, de l’inaccessible.
- Accueil
- Actualité
- Politique
- Société
- Economie
- Culture
- Sports
- Faits-Divers
- Lifestyle
- Auto
- Emploi
- Médias
Copyright © 2022 Aujourd'hui le maroc Conception et développement SG2I Consulting
Articles similaires
Culture
Propriété intellectuelle : L’OMPI appuie le Maroc
L’organisation soutient tous les aspects de la vie dont le zellige
ParALM25 avril 2024
Culture
Un appel à candidatures vient d’être lancé / FIFM 2024 : A vos films !
Le Festival international du film de Marrakech (FIFM) lance un appel à...
ParALM24 avril 2024
Culture
«Jam Show» sur 2M : elGrandeToto et Dizzy Dros président le jury
Elle vise à promouvoir les talents émergents de la scène rap marocaine
ParALM24 avril 2024
Culture
Villes intelligentes : Seconde édition du salon pédagogique, cette fois-ci à Agadir
Après Casablanca c’est au tour de la ville d’Agadir d’accueillir la seconde...
ParDounia Essabban23 avril 2024