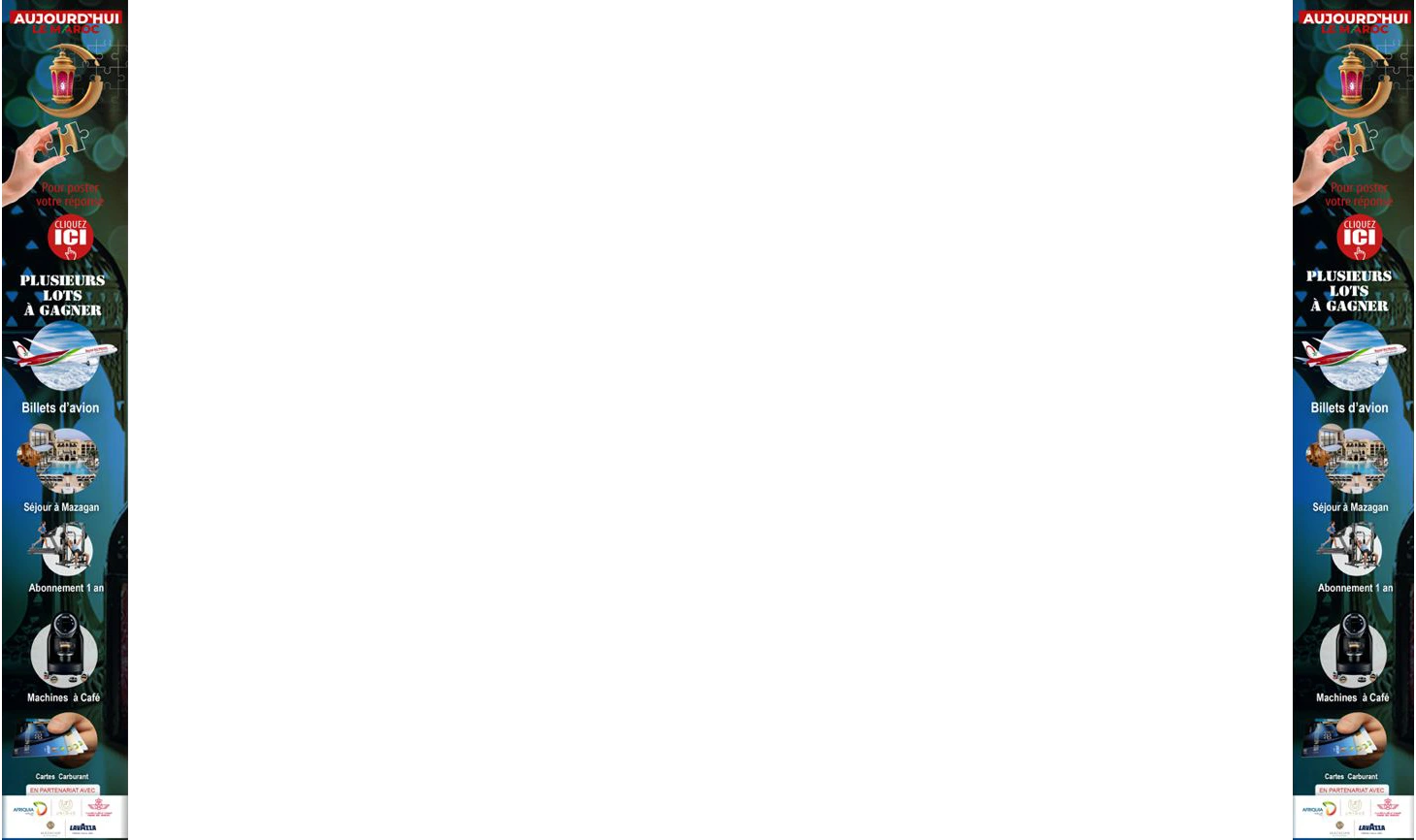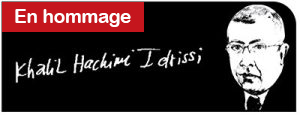Dans le passé, les démocraties y ont eu recours, puisque des pays comme la Grande-Bretagne et la France ont mis à l’oeuvre cette idéologie dans leurs campagnes coloniales. La présence de cette pensée est donc bien possible en démocratie, mais la combinaison des deux est-elle pour autant harmonieuse ? Au vrai, l’idée démocratique n’a pu s’affirmer qu’au fur et à mesure que s’ébranlait l’unité du théologique et du politique. Exigée par les philosophes de la Renaissance et de l’âge classique, cette rupture se traduit dans les faits par la création des premières démocraties, américaine et française, avant d’aboutir à la séparation définitive entre l’Eglise et l’Etat. Quel est son sens ? Tel individu croit qu’il mène une vie bien plus admirable que son voisin ; pourtant, dans une démocratie, il n’a pas le droit d’imposer son propre mode de vie aux autres par la force. L’Etat assure la paix entre citoyens, fixe une limite inférieure à ne pas transgresser (là où il y a crime ou délit), mais ne formule pas un idéal que tous seraient contraints d’embrasser. En ce sens, la démocratie n’est pas un Etat « vertueux ». On retrouve cette séparation dans la vie internationale, même si elle se manifeste sous une forme différente. Telle population croit toujours que son Dieu est supérieur à celui du voisin, que c’est donc elle et non lui qui détient le Bien suprême ; elle renonce pourtant à lui déclarer la guerre pour lui imposer ce Bien. La démocratie signifie que chaque peuple est souverain, qu’il a donc aussi le droit de définir pour lui-même le Bien, plutôt que de se le voir imposer du dehors. Par conséquent, lorsque les puissances occidentales conduisent leurs guerres coloniales au nom de la démocratie dont elles se veulent l’incarnation, les moyens utilisés annulent le but poursuivi. Comment peut-on « promouvoir la dignité humaine » des autres si on ne les laisse pas décider de leur propre sort ? Si on impose la liberté aux autres, on les soumet ; si on leur impose l’égalité, on les juge inférieurs. De son côté, l’idéal de la démocratie libérale ne se confond pas avec celui du conservatisme. Il est vrai que, en ne se donnant pas comme but de bâtir le paradis ici et maintenant, d’assurer le triomphe définitif de la liberté sur ses ennemis, la démocratie libérale renonce à sacrifier le présent à l’avenir, des individus, à justifier les morts individuelles par les nobles objectifs qu’elles sont censées servir (citons à nouveau les « bombes humanitaires » et les « dommages collatéraux »). Mais son idéal ne consiste pas non plus à se résigner au monde tel qu’il est, à se contenter de le contempler dans la sérénité. Elle est à son tour opposée aux tyrans, mais cherche à les combattre par des moyens autres que ceux des néofondamentalistes : en les dénonçant publiquement, en ne reconnaissant pas la légitimité de leur gouvernement, en mettant leur pays au ban des nations, et par toutes sortes d’autres initiatives diplomatiques politiques ou économiques. Ce choix-là – de la négociation au détriment de l’intervention, de l’endiguement plutôt que de l’occupation du territoire ennemi – a ses inconvénients : ses résultats sont plus lents à venir, et ils n’assurent pas une auréole héroïque à ses initiateurs. Pourtant, du point de vue démocratique, lorsqu’on peut atteindre le même but par deux voies – rapidement par la violence ou lentement sans elle -, la lenteur est préférable. Mieux vaut désarmer l’Irak en quatre mois sans tuer personne que de le désarmer en quatre semaines en tuant des milliers d’individus. C’est ainsi qu’ont procédé les pays occidentaux dans les décennies précédentes à l’égard de régimes qu’ils condamnaient, tels que celui de l’Afrique du Sud ou encore de l’Union soviétique. Comment le gouvernement américain a-t-il contribué à la chute de cette dernière? Reagan n’avait pas modifié la politique d’endiguement envers l’« Empire du mal », il y avait seulement ajouté une compétition dans l’armement qui allait révéler la faiblesse structurelle de l’Etat communiste. Il a donc remporté la victoire sans tirer un seul coup de feu. Le projet qui consiste à déclarer la guerre à tous les tyrans et à toutes les injustices est à mettre en question non seulement parce qu’il est impossible à réaliser (la tâche est surhumaine) ni parce qu’il imposerait un état de guerre permanent et contribuerait donc à renforcer toutes les armées et toutes les polices du monde (singulier effet du combat pour la liberté). Le grand écrivain russe Vassili Grossman, analyste remarquable du totalitarisme du XXème siècle, constatait : « Là où se lève l’aube du Bien, des enfants et des vieillards périssent, le sang coule. » (Vie et Destin, p.382) Pourquoi faut-il renoncer à imposer le Bien par la force ? Parce que les risques sont trop grands qu’il en sorte plus de souffrances que de joies : la fin noble ne justifie pas les moyens ignobles. Les victimes de la tentation du Bien sont infiniment plus nombreuses que celles de la tentation du mal. C’est pourquoi Grossman recommandait de cultiver la bonté plutôt que le Bien, de se soucier des individus au lieu des abstractions ; or, de ce point de vue « démocratie », « liberté » et « prospérité » ne valent pas mieux que « révolution », « communisme » et « société sans classes ». Les idéaux admirables ne suffisent pas à assurer le bonheur de l’humanité : pendant qu’on les promeut, « des enfants et des vieillards périssent, le sang coule ». Les politiques extérieure et intérieure d’une démocratie libérale ne prennent pas les mêmes formes. A l’intérieur du pays, l’Etat peut recourir à la contrainte (à la police) pour protéger son pouvoir ou pour faire régner la justice. Entre pays, il ne renonce pas à l’usage de la force ; mais il s’en sert pour assurer son intangibilité, pour protéger ses citoyens et leurs biens, non pour imposer un ordre idéal à tous. Là réside la différence entre démocraties et Etats totalitaires (ou autres incarnations de l’unité entre théologique et politique) : les premières utilisent leurs forces armées en vue de leur légitime défense, les seconds, pour changer le reste du monde. Combattre pour la perfection d’autrui – plutôt que de soi – ne s’inscrit pas dans le cadre de la morale démocratique. La comparaison des guerres actuelles avec celle contre l’Allemagne nazie ou le Japon ne tient pas pour cette raison : ces deux pays en avaient attaqué d’autres, qui étaient dans leur plein droit de se défendre par les armes. Que les Etats-Unis, après leur victoire sur l’Allemagne et le Japon, aient contribué à mettre en place la démocratie dans ces pays est tout à leur honneur ; mais ils n’avaient pas engagé la guerre à cette fin. C’est pourquoi est incompatible aussi avec l’esprit démocratique la notion récemment popularisée de « droit d’ingérence ». La guerre en Irak se situe, de ce point de vue, dans le droit fil de l’intervention au Kosovo, qui a vu l’apparition de cette expression dans la rhétorique militaire. La seule différence entre les deux est qu’en Yougoslavie, en 1999, les intervenants se sont contentés de soustraire une province au contrôle du gouvernement central sans demander le renversement de celui-ci ; alors qu’en Irak en 2003, le départ du gouvernement était exigé. Le « droit d’ingérence » voudrait, lui, se réclamer de la démocratie – mais il le fait au prix d’un glissement de sens inadmissible. Au départ, l’«ingérence » à laquelle on pensait était humanitaire. Prendre l’initiative d’aider les blessés et les souffrants d’un pays étranger ne menace en rien la souveraineté nationale. Dans un deuxième temps, on a évoqué le besoin de protéger militairement les intervenants humanitaires. Enfin, troisième pas, mais qui contredit l’esprit de la démarche initiale : on justifie l’attaque militaire par une situation déplorable sur le plan humanitaire et l’on agit comme si l’effet principal de la guerre était de faire respecter les droits de l’homme. C’est ainsi qu’on aboutit à ce chef-d’oeuvre de la novocaïne qu’est la « guerre humanitaire ». Est-ce à dire que, pour peu qu’on se place dans l’optique démocratique, l’intervention militaire n’est justifiée en aucun cas autre que la légitime défense ? Non ; elle l’est aussi dans ce cas extrême qu’est le génocide, non en raison d’un imaginaire droit d’ingérence qu’on se serait attribué soi-même, mais par devoir d’humanité. La quantité bascule ici en qualité : quand on extermine un groupe constitutif de l’humanité, nous sommes tous concernés, même si nous n’en faisons pas partie. Cependant, toute infraction aux droits de l’homme n’est – heureusement – pas un génocide, ni tout tyran un Hitler. Mieux vaut laisser reposer le spectre du dictateur nazi et ne pas abuser de comparaison qui déroutent au lieu d’éclairer. La loi du tiers exclu ne régit pas le domaine politique et l’action non guerrière reste possible : les démocraties ne sont pas vraiment obligées de choisir entre Munich (lâche capitulation) et Dresde (bombardements meurtriers).
ragilité de l’empire
La justification de la guerre par le désir d’imposer la démocratie n’en est pas une : insuffisant en lui-même, cet argument est de plus trop souvent un simple leurre derrière lequel se profile un mobile plus traditionnel, à savoir l’intérêt national. Celui-ci ne devrait pourtant en aucune façon être considéré comme inavouable, puisque c’est le premier devoir de tout gouvernement que de le défendre. La politique extérieure des Etats-Unis ne fait pas exception à cet égard ; mais elle possède aussi deux caractéristiques plus spécifiques. Premièrement, ce pays considère que ses intérêts entrent en jeu sur toute la surface du globe ; et deuxièmement, il est prêt pour les défendre à faire immédiatement usage de sa force militaire. La conjonction de ces deux traits fait souvent dire que la politique extérieure des Etats-Unis est une politique impériale. L’adjectif « impérialiste » passe, depuis assez longtemps déjà, pour une injure, et personne ne veut l’inscrire sur son drapeau. Comme le remarquait Raymond Aron dans une étude publiée en 1959, seuls les autres sont qualifiés de cette manière.
- Accueil
- Actualité
- Politique
- Société
- Economie
- Culture
- Sports
- Faits-Divers
- Lifestyle
- Auto
- Emploi
- Médias
Copyright © 2022 Aujourd'hui le maroc Conception et développement SG2I Consulting
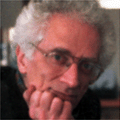
© D.R
Articles similaires
SociétéSpécialUne
Plus de 28.000 nouveaux inscrits en 2022-2023 : De plus en plus d’étudiants dans le privé
L’enseignement supérieur privé au Maroc attire des milliers de jeunes chaque année.
ParALM19 avril 2024
SociétéSpécial
Enseignement supérieur privé : CDG Invest entre dans le capital du Groupe Atlantique
CDG Invest a réalisé une prise de participation de 20% via son...
ParALM19 avril 2024
SpécialUne
Forum académique Maroc-Espagne : Un partenariat tourné vers la recherche et l’innovation
Les présidents des universités marocaines et espagnoles se sont réunis, mercredi à...
Paralm19 avril 2024
FormationSpécialUne
Excelia Business School : Lancement du Doctorate in Business Administration à la rentrée 2024
Excelia Business School lance son Doctorate in Business Administration en septembre 2024....
Paralm19 avril 2024