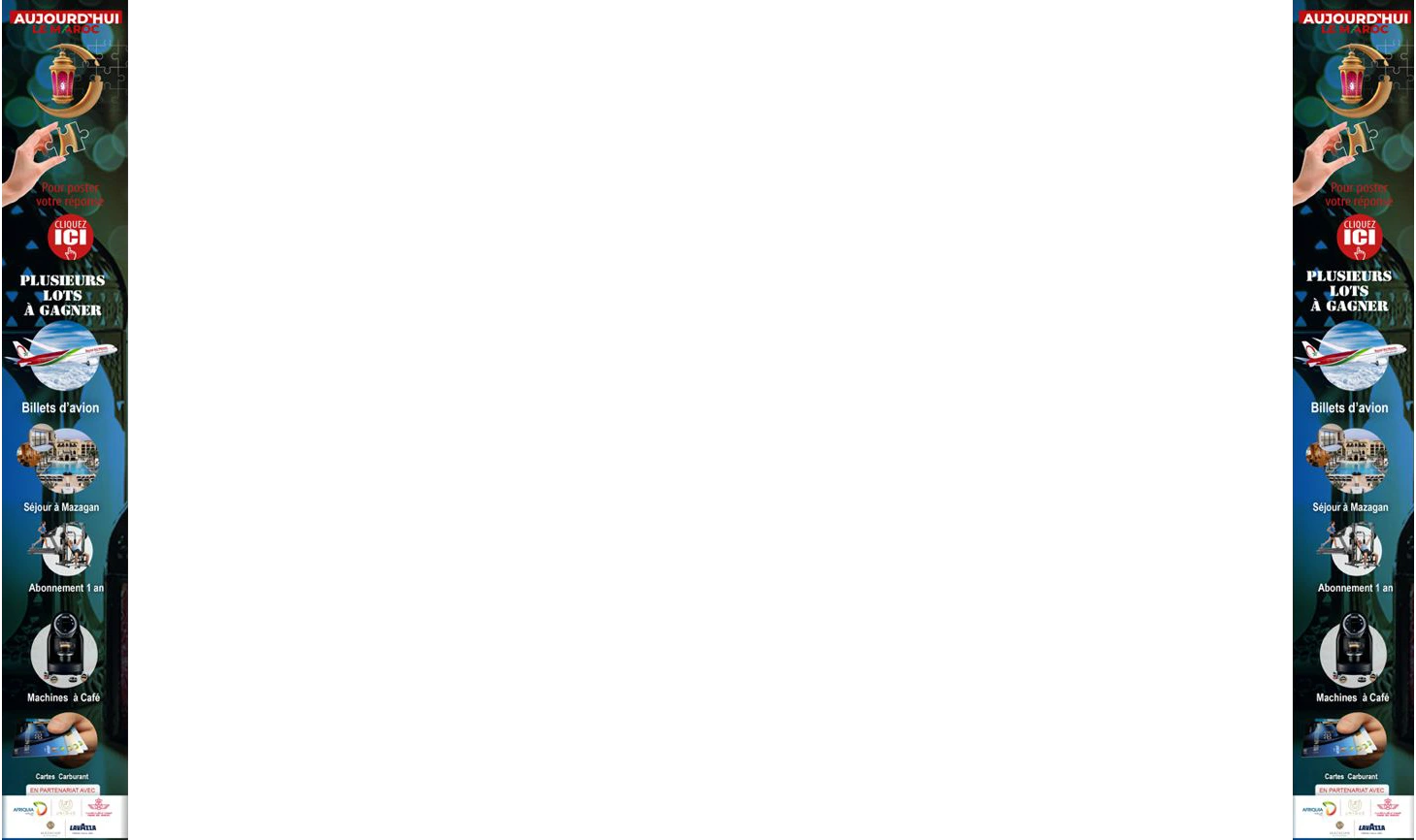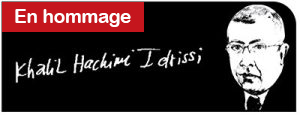Votre panier est vide.
- Accueil
- Actualité
- Politique
- Société
- Economie
- Culture
- Sports
- Faits-Divers
- Lifestyle
- Auto
- Emploi
- Médias
Copyright © 2022 Aujourd'hui le maroc Conception et développement SG2I Consulting
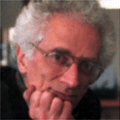
© D.R
Cela est particulièrement vrai pour ce qui concerne la menace terroriste, qui ne s’incarne pas dans une armée régulière. De ce point de vue le ministre français des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, a raison quand il dit au Conseil de sécurité de l’ONU, le 19 mars 2003: « Dans un monde où la menace est asymétrique, où le faible défie le fort, la capacité de convaincre, la faculté de faire évoluer les esprits comptent autant que le nombre de divisions militaires». L’intérêt des Etats-Unis serait mieux préservé s’ils renonçaient à cette politique aventureuse qui pourrait les amener, demain, à utiliser les armes nucléaires en première frappe ; et si, au lieu de cela, ils prenaient soin de donner une légitimité à leurs actes aux yeux du reste du monde. Mais qu’est-ce qui permet de rendre une politique légitime ? Les penseurs du passé ont longuement débattu cette question, en réfléchissant aux principes du droit politique. Ce n’est pas le simple fait de détenir le pouvoir : celui-ci est souvent acquis à l’origine par la violence (la guerre d’indépendance préside à la démocratie américaine, comme la révolution de 1789 à la démocratie française). Et même lorsque le pouvoir est l’expression légale de la volonté populaire, il peut errer : l’opinion de la majorité n’est pas forcément éclairée, elle peut aussi agir contre l’esprit de la justice. Ce ne sont pas non plus les nobles objectifs qu’on se donne : le puissant sera toujours soupçonné de s’en servir pour dissimuler ses appétits. Mais alors, où trouver cette légitimité ? C’est Montesquieu, au XVIIIème siècle, qui apporte la réponse en cette brève formule : « Tout pouvoir sans bornes ne saurait être légitime. » (Lettres persanes, lettre 104). Ce n’est ni l’origine qui donne la légitimité, ni la finalité ; c’est la manière même d’exercer le pouvoir. A savoir, en lui imposant des bornes, en le partageant avec d’autres. Deux conceptions s’affrontent ici, l’une qui se met sous le signe de l’unité, l’autre de la pluralité. L’une croit détenir le Bien et se considère par conséquent en droit de l’imposer à tous. L’autre espère aussi être la meilleure mais ne se permet pas de compter dessus, et juge que la répartition et la séparation des pouvoirs sont préférables à leur unification. Plusieurs partis valent mieux qu’un, même si c’est le meilleur d’entre eux. A l’intérieur du pays, la limitation du pouvoir vient de l’indépendance entre exécutif, législatif et judiciaire, comme de la pluralité des partis et des sources d’information, ou encore de l’attribution de droites aux minorités. Dans la vie internationale, elle vient du respect de la souveraineté des autres Etats, même si l’on a la force de les soumettre, et du respect des traités et conventions entre pays, même quand on a la possibilité de les transgresser. Cette acceptation du pluralisme est le meilleur moyen de protéger l’autonomie de chacun, et par là d’obtenir son adhésion. Les traités entre pays ou les obligations envers une organisation internationale comme l’ONU n’ont pas la vigueur des lois qui régissent la vie à l’intérieur du pays ; mais, étant une restriction volontairement consentie à l’usage de la force, ils participent au partage pluraliste du pouvoir mondial. Or, au moment de déclencher la guerre contre l’Irak, les Etats-Unis ont traité ces conventions internationales avec beaucoup de désinvolture. Il faut dire que leurs intentions avaient été clairement formulées dans The National Security. On pouvait y lire en effet : « Bien que les Etats-Unis soient prêts à déployer tous leurs efforts pour obtenir le soutien de la communauté internationale, nous n’hésiterons pas à agir seuls, si nécessaire. » Autrement dit : la légitimité accordée par l’ONU est un camouflage – souhaitable mais non nécessaire – de la force. L’effet négatif de telles déclarations est difficile à mesurer. On dit souvent, contre l’idéal pluraliste dans les relations internationales, que l’on fait appel au droit, aux règles, au respect que l’on doit aux faibles uniquement quand on est soi-même faible ; si seulement on était fort, on transgresserait allégrement ces conventions pour satisfaire immédiatement nos désirs. L’argument remonte loin : un personnage, dans La République de Platon, évoque à ce propos la légende de Gygès. Celui-ci possède un anneau qui peut le rendre invisible, ce qui lui donne la puissance absolue. Il peut ainsi voler et s’enrichir, tuer et s’emparer du pouvoir. Combien seraient ceux qui, s’ils disposaient de l’anneau de Gygès, auraient eu la fermeté d’âme nécessaire pour résister à la tentation ? Combien renonceraient à l’omnipotence qui les rapprocherait des dieux ? A en croire la légende, « personne n’est juste de son plein gré, mais par contrainte » (360c). Mais cette conception de l’homme est doublement erronée : d’abord parce que les principes de justice ne sont pas de pure convention et que leur transgression fait souffrir intérieurement celui-là même qui la commet ; et surtout parce que le bon exercice du pouvoir, qui est l’exercice partagé, sert le meilleur intérêt de celui qui le pratique, en lui assurant la bienveillance des autres et leur adhésion à une démarche commune. On dit souvent aussi que le pluralisme ne se décrète pas mais doit être constaté dans les faits ; or les Etats-Unis sont déjà, sur le plan militaire, beaucoup plus forts que toute autre puissance sur terre, et même que l’ensemble de ces puissances. Faut-il souhaiter, pour rétablir l’équilibre, que se relance une course aux armements ? Sûrement pas. Que les Etats-Unis possèdent la plus grande force militaire du monde est une chose ; qu’ils s’en servent pour obtenir la satisfaction immédiate de leurs désirs en est une autre. Ce dont il s’agit n’est pas une nouvelle contrainte, exercée cette fois-ci sur le gouvernement américain, mais une autolimitation volontaire dans l’exercice du pouvoir, au nom de l’intérêt bien compris du pays. On se demande également, parfois, si un monde pluraliste (on dit aujourd’hui « multipolaire ») ne serait pas condamné à la confrontation permanente, chacun cherchant à tout moment à surclasser les autres. L’égalité de départ n’encourage-t-elle pas la compétition ? La paix par l’empire, la soumission définitive à la plus grande puissance n’est-elle pas préférable pour la tranquillité de tous ? Mais on n’est pas obligé de s’en tenir à cette alternative brutale, guerre ou soumission. En matière de relations internationales, l’adage (hélas évangélique) « qui n’est pas avec nous est contre nous » ne s’applique pas. Le schéma simpliste « ami/ennemi » a beau être fort répandu, il rend mal compte de la diversité de relations entre pays. Celles-ci vont du partenariat actif à la compétition pacifique, en passant par les collaborations ponctuelles ou la neutralité. Cet équilibre international ne sera pas définitif – mais une telle souplesse et capacité d’accueillir l’imprévu n’est-elle pas préférable à un ordre fixé une fois pour toutes ? Je rejoins par là la conclusion, nullement angélique, de Kant qui disait préférer la « coexistence des Etats à leur réunion sous une puissance supérieure aux autres », l’équilibre qui s’établit entre eux, « malgré la lutte qui résulte de leur diversité », à la paix définitive imposée par l’empire (Euvres philosophiques, III, pp.361-362). Une puissance comme les Etats-Unis ne renoncera évidemment jamais à l’usage de la force. Mais cela ne veut pas dire qu’elle doit se laisser aller à l’ivresse que procures la conscience d’être le plus fort, excitée de surcroît par la conviction d’être le plus juste. L’orgueil est rarement bon conseiller. Il est de l’intérêt des Etats-Unis d’accepter des limitations volontaires à l’usage de leur puissance, comme du reste le leur recommandent certaines voix, nullement antiaméricaines, à l’intérieur même du pays. Il faudrait dans ce cas n’utiliser la force militaire qu’en légitime défense, en cas d’agression contre soi (comme en Afghanistan) ou contre ses alliés (comme au Koweït). Le reste du temps, respecter militairement l’ordre international, aussi imparfait qu’il soit, et les souverainetés nationales, aussi détestables que soient les régimes qui s’en protègent ; mais chercher à les transformer par des moyens pacifiques – qui eux-mêmes, il faut le rappeler, ne manquent pas de puissance.
Force ou droit ? La stratégie américaine dans le conflit irakien a été critiquée dans de nombreux pays, y compris par certains gouvernements alliés, au premier rang desquels s’est placée la France. L’argument le plus fréquemment utilisé a été que les Etats-Unis conduisaient une politique de force, alors que les relations internationales devraient obéir au droit, incarné en l’occurrence par l’Organisation des Nations unies, son Conseil de sécurité et leurs résolutions. Le 7 mars 2003, quelques jours donc avant le déclenchement des hostilités, Dominique de Villepin annonçait devant le Conseil de sécurité : « Certains pensent que l’on peut régler ces problèmes par la voie de la force et créer ainsi un nouvel ordre. Ce n’est pas la conviction de la France. » Le 18 mars 2003, la veille de l’invasion, pour justifier sa position au Conseil de sécurité, le président Chirac déclarait à la presse que, à la différence des Etats-Unis qui veulent « privilégier la force sur le droit », la France « a agi au nom de la primauté du droit et en vertu de sa conception des rapports entre les peuples et entre les nations».
Articles similaires
EconomieSpécialUne
Dessalement de l’eau de mer à des fins agricoles : Le chantier en marche
Le dessalement de l’eau de mer permettra de libérer les ressources aux...
ParKawtar Tali22 avril 2024
SpécialUne
Les dernières pluies sauvent la mise
Le stress hydrique auquel le Royaume est exposé ces dernières années a...
Paralm22 avril 2024
ActualitéSpécialUne
Tout savoir sur les mesures prises au titre de la campagne 2023-2024
Les mesures prises s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour la...
Paralm22 avril 2024