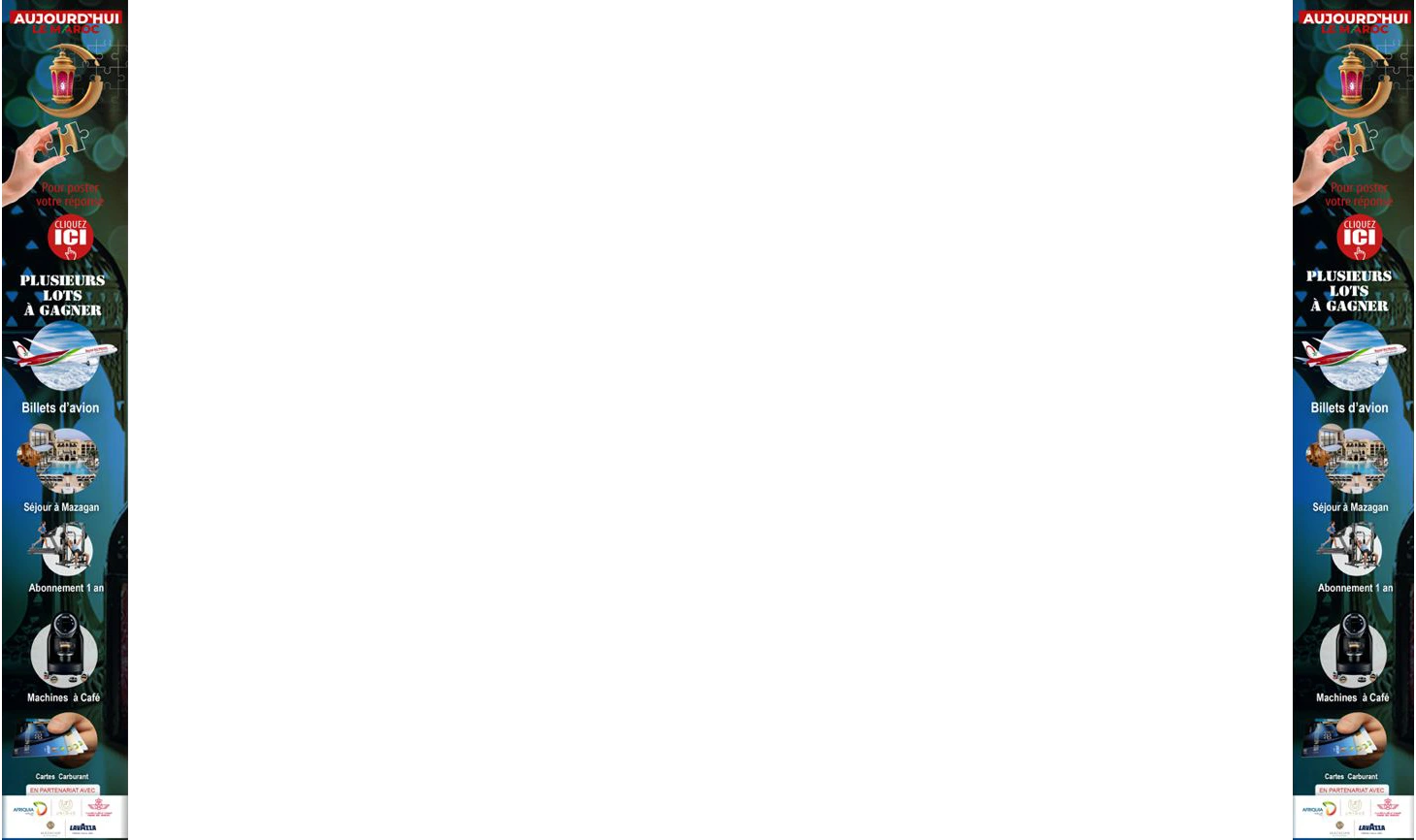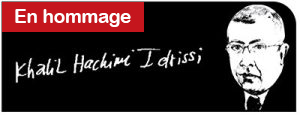Il demandait donc que « la légalité internationale soit respectée ». Une fois la guerre engagée, les dirigeants français n’ont pas changé d’avis. S’exprimant devant l’Institut international d’études stratégiques à Londres, le 27 mars 2003, Villepin réitérait sa foi dans les « normes collectives visant à contenir l’emploi de la force », ajoutant : « Seul le consensus et le respect du droit donnent à la force la légitimité nécessaire. » Il concluait : « La force doit être mise au service du droit. » Il est revenu sur ce thème, une fois la guerre terminée, dans un entretien (au journal Le Monde, le 13 mai 2003) : « Le rôle de l’ONU est plus que jamais irremplaçable », déclarait-il. «Les Nations unies incarnent une conscience universelle au-dessus des Etats », elles constituent un pas vers la « constitution d’une démocratie mondiale ». D’autres dirigeants européens ont également exprimé l’opinion qu’aujourd’hui le règne de la force touche à sa fin et qu’il est progressivement remplacé par celui du droit ; de ce fait, la guerre pourrait être définitivement bannie. Une telle vision du monde a évidemment de quoi séduire. Mais avant d’y aller adhérer, il faut se demander : rend-elle bien compte du monde réellement existant ? Ou serions-nous en train de prendre nos désirs pour des réalités? Pour bien juger, il faut connaître ; or on cherche mal la vérité si l’on sait d’avance qu’elle doit être conforme au bien. Le règne du droit sur la force est-il effectif ou s’agit-il là d’une illusion, flatteuse sur le moment mais qui risque d’égarer nos choix ? La « légalité internationale » et la « démocratie mondiale » sont-elles autre chose que des fictions juridiques ? Au siècle des lumières, encyclopédistes et philosophes nourrissaient l’espoir que le progrès de la civilisation au sein de chaque pays allait s’étendre sur les relations entre pays ; que le monde entier pouvait être pensé comme une « société générale » dont les sociétés particulières seraient comme les citoyens. C’est Jean-Jacques Rousseau qui s’est chargé de balayer leurs fragiles constructions. «D’homme à homme, écrit-il, nous vivons dans l’état civil et soumis aux lois ; de peuple à peuple, chacun jouit de la liberté naturelle. » «(Euvres complètes, III, p.610) Ou encore : entre pays les rapports restent dans l’état de nature ; dans chaque pays règne en revanche l’état de société. Pourquoi est-ce ainsi ? Parce que les citoyens de chaque pays ont renoncé à l’usage de la violence, en la confiant à l’Etat qui les englobe ; alors que les pays, ne faisant pas partie d’un Etat universel, ne connaissent pas d’insistance à laquelle ils pourraient déléguer leur force ; ils la gardent donc pour eux. A moins d’être menacés par un ennemi commun – les Etats privilégient l’intérêt particulier au détriment de l’intérêt général (ce qu’illustrent, entre autres, les difficultés rencontrées pour trouver un accord sur des sujets comme le réchauffement de la planète). Tous les Etats connaissent ce double régime : ce ne sont pas les mêmes principes qui régissent politique intérieure et extérieure. Au-dedans, la force est soumise au droit, l’armée est aux ordres du gouvernement, la police assure le fonctionnement de la justice. Au-dehors, c’est la force qui régit les rapports entre pays, tempérée seulement par les contrats qu’il établissent entre eux par leur volonté, mais qu’ils peuvent aussi rompre à tout instant. Le droit international n’a pas la même efficacité que le droit national, parce qu’il ne possède pas de la même manière un bras armé – à moins que les Etats n’acceptent volontairement ce droit. Plutôt que soumises au droit, les relations entre pays relèvent d’un ordre international, fait de traités, de conventions et aussi de participation aux organisations internationales ; mais cet ordre n’est pas garanti par une police mondiale – celle-ci n’existe pas plus que l’Etat universel. C’est pourquoi il est un peu futile de parler, comme on l’a fait au moment du conflit irakien, de «guerre illégale». Dans sa définition même, la guerre – tout guerre – est une rupture de l’ordre international préexistant ; mais celui-ci n’a jamais eu puissance de loi. Il est donc vain d’invoquer dans ce contexte la « primauté du droit», le « respect du droit» ou les «normes collectives » : les contrats existant entre pays, qu’il a toujours été loisible de rompre unilatéralement, ne sont pas des lois ; ce qu’on appelle le droit international n’appartient simplement pas à la même catégorie que la puissance militaire. Il est vrai que ce raisonnement ne s’applique pas aux pays membres de l’Union européenne dans leurs relations mutuelles : ceux-ci ont renoncé à l’usage entre eux de la force armée. Mais ce renoncement ne va pas au-delà des frontières de l’Union : les guerres avec des pays extérieurs sont concevables, aucune loi ne saurait les interdire. Qu’en est-il alors du rôle de l’ONU, organisme incluant tous les pays du monde, n’est-il pas une incarnation de ce que la force peut être jugulée par le droit ? Il faudrait d’abord, pour renoncer à cette illusion, se rappeler qu’à la base de l’ONU se trouve un choix que ne fonde aucun droit, à savoir l’octroi du « droit de veto » aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité. En d’autres termes, ces cinq-là – les grandes puissances – sont exempts des obligations pesant sur les autres, puisqu’ils peuvent imposer leur veto sur toute résolution les concernant. Un puissant ne saurait errer ! C’est ainsi que l’URSS, dans un passé récent, échappait à toute condamnation entraînant une intervention, puisqu’elle empêchait toute résolution concernant ses actes. Cette protection peut être étendue, des «membres à veto» à leurs alliés : de cette manière Israël, protégé par les Etats-Unis, ne risque pas de subir une intervention décidée par l’ONU. Loin, donc, de restreindre l’hégémonie des grandes puissances, l’Organisation mondiale la consacre. Il faut ajouter que, même lorsque l’ONU n’était pas paralysée par l’une de ces puissances, elle ne s’est guère révélée comme une belle incarnation de la justice en marche. Nombreux sont les massacres que l’ONU n’a pas su ou voulu empêcher : génocides au Cambodge et au Rwanda, tueries massives au Soudan et en Ethiopie, guerres civiles en Angola et en Sierra Leone… Les raisons ponctuelles sont diverses, mais leur origine est commune : l’inefficacité d’une organisation qui ne dispose pas d’une force propre, mais doit emprunter celle des pays particuliers. A quoi s’ajoute la lourdeur inévitable d’une machine bureaucratique lointaine et les divergences d’intérêts des pays membres, toujours prêts à lui mettre des bâtons dans les roues. Il s’en faut de beaucoup que la conduite de tous les Etats soit dictée par les seules considérations du droit. Souvenons-nous, en mars 2003, à propos de l’Irak justement, comment les émissaires américains et français parcouraient le globe, pour exercer des pressions ou promettre des récompenses, en vue d’obtenir le vote favorable de tel ou tel pays. Peut-on y voir vraiment une manifestation de cette «conscience universelle » dont parle Villepin ? Peut-on voir un triomphe de la justice dans le fonctionnement de la Commission des droits de l’homme de l’ONU (présidée actuellement par la Libye !), qui n’a jamais cherché à condamner pour leurs infractions aux droits de l’Homme des pays comme la Chine ou le Vietnam, l’Algérie ou la Syrie, le Soudan ou le Zimbabwe? Lors de la crise irakienne, l’ONU a été soumise à dure épreuve. Son Conseil de sécurité avait à choisir entre deux solutions désagréables : ou bien se soumettre aux Etats-Unis en montrant sa servilité, ou bien s’y opposer, en montrant son impuissance. Il a opté plutôt pour la seconde et on pourrait plaider qu’il a, de cette manière, sauvé l’honneur ; sa faiblesse n’en a pas moins été révélée au grand jour. Les Lilliputiens qui essayaient d’entraver Gulliver par de multiples liens se sont éparpillés dès que le géant a décidé de se lever. La France s’enorgueillissait de gagner la bataille à l’ONU – mais elle a perdu celle qui se jouait en dehors des salles de réunion, puisque la guerre a eu lieu. Or une politique se juge, non à ses intentions, mais à ses résultats ; c’était donc une mauvaise politique. Du reste, la France elle-même, très chatouilleuse sur les questions de droit lorsqu’elles concernent plus fort qu’elle, ne se soumet pas toujours à l’ONU lorsqu’il s’agit de ses propres affaires. Le général de Gaulle ne manquait pas une occasion pour déclarer d’avance son insoumission à une organisation où siègeaient tant de dictateurs. En 2003 même, la France n’a pas tout à fait renoncé à «régler ces problèmes par la voie de la force», pour parler comme Villepin pour intervenir en Côte-d’Ivoire, et sans doute est-ce une bonne chose : de nouveaux massacres auraient probablement eu lieu avant que ne se dégage le consensus nécessaire. On ne peut s’empêcher de penser que si, au moment de la crise irakienne, la France a tant insisté sur la nécessité d’en passer par l’ONU et son Conseil de sécurité, c’est parce que c’était le seul lieu où elle pouvait assumer un rôle de puissance mondiale.
- Accueil
- Actualité
- Politique
- Société
- Economie
- Culture
- Sports
- Faits-Divers
- Lifestyle
- Auto
- Emploi
- Médias
Copyright © 2022 Aujourd'hui le maroc Conception et développement SG2I Consulting

© D.R
Articles similaires
EconomieSpécialUne
Dessalement de l’eau de mer à des fins agricoles : Le chantier en marche
Le dessalement de l’eau de mer permettra de libérer les ressources aux...
ParKawtar Tali22 avril 2024
SpécialUne
Les dernières pluies sauvent la mise
Le stress hydrique auquel le Royaume est exposé ces dernières années a...
Paralm22 avril 2024
ActualitéSpécialUne
Tout savoir sur les mesures prises au titre de la campagne 2023-2024
Les mesures prises s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour la...
Paralm22 avril 2024
EconomieSpécialUne
Efficacité hydrique et énergétique : Les promesses de la Génération Green
L’optimisation des ressources hydriques sera accompagnée par la promotion des énergies renouvelables...
ParKawtar Tali22 avril 2024