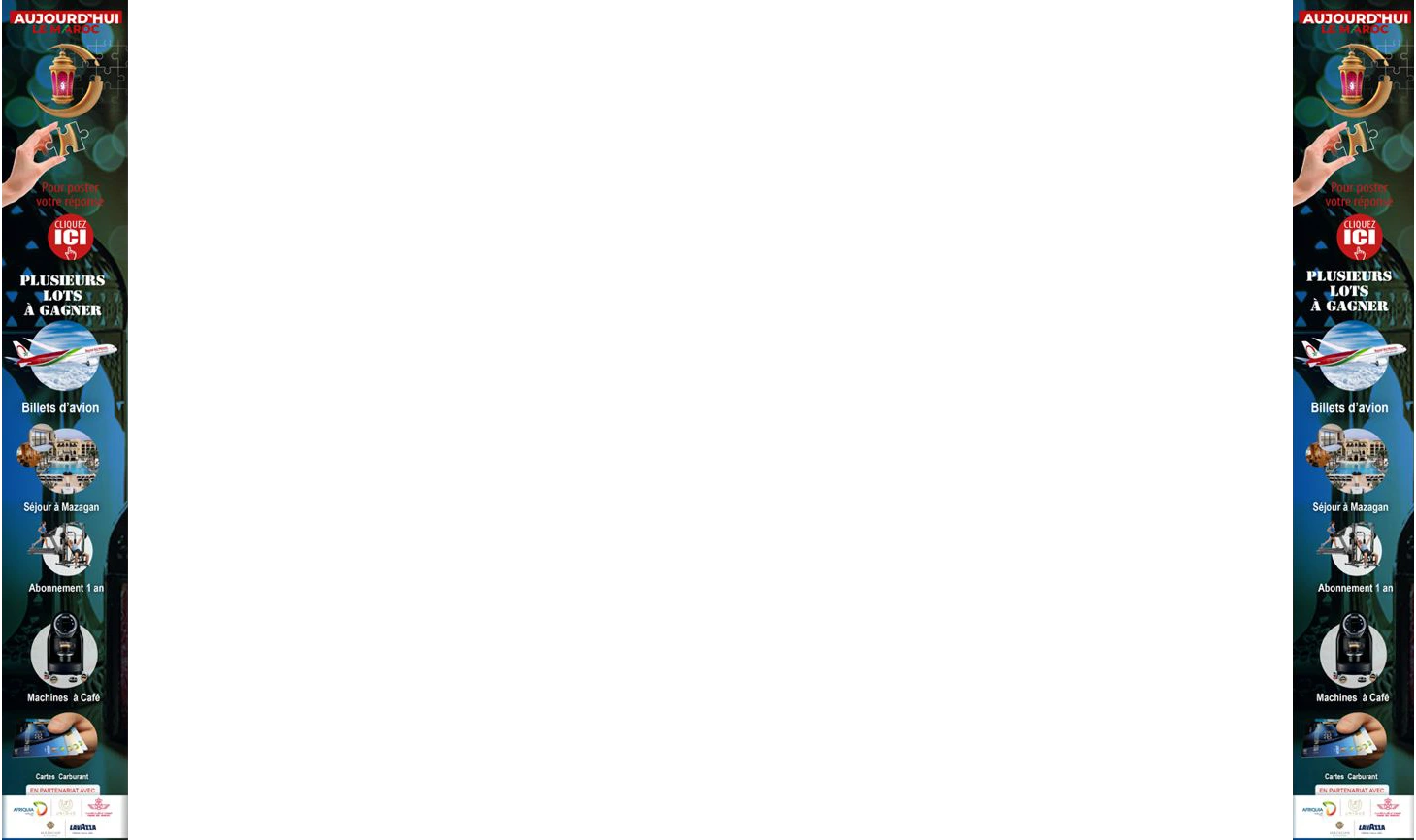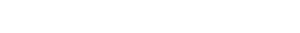«L’impérialisme est le nom que le rival ou les spectateurs donnent à la diplomatie d’une grande puissance. » La puissance en question, au contraire, cherchera toujours à nier cette apparence à une espèce honnie, mais cette négation, à son tour, ne peut écarter tout soupçon. «Le langage sublime ne suffit pas à garantir le règne du droit, poursuivait Aron, il assure plutôt celui de l’hypocrisie. Désormais, les impérialistes se présentent masqués et ils baptisent libération ce que les hommes en d’autres siècles eussent appelé oppression. » (Etudes politiques, p.506). Quoi qu’il en soit du terme « impérialiste », la politique des Etats-Unis est incontestablement impériale, en raison de la présence avérée des deux traits mentionnés. Toutes les politiques impériales ne se ressemblent pas pour autant. Le colonialisme français ou britannique du XIXème siècle en illustrant une variante, avec l’établissement d’une hiérarchie explicite entre métropole et colonie ; la politique annexionniste de l’URSS, au XXème siècle, qui intégrait de nouveaux territoires américains ne ressemble ni à l’un ni à l’autre, les Etats-Unis n’occupent pas les pays étrangers ni ne cherchent à se les annexer ; ils se contentent d’exiger que leurs gouvernements ne leur soient pas hostiles, ni sur le plan politique ni sur celui de l’économie. Le terme d’« hégémonie » est peut-être celui qui convient le mieux à ce type de stratégie impériale. Depuis quand ce choix a-t-il été adopté ? Tout grand pays cherche à étendre le rayon de son influence et les Etats-Unis ont été un grand pays depuis leur fondation. Cependant, quelques événements plus récents ont contribué à renforcer leur rôle et à leur réserver, parmi les grandes puissances mêmes, une place exceptionnelle. Le pas initial est franchi au cours de la deuxième guerre mondiale, lorsque les anciennes puissances occidentales – Allemagne, France, Grande-Bretagne – se trouvent écartées de la compétition et distancées par les Etats-Unis. Le degré suivant est atteint au moment de la dislocation de l’empire rival, celui de l’Union soviétique. Or non seulement les Etats-Unis restent sans adversaire à leur niveau de puissance, mais de plus ils décident, quelques années après la chute du Mur, de renoncer à toucher, comme on dit, les dividendes de la paix, à profiter donc de l’absence d’une course aux armements pour jouir immédiatement de leur richesse. Bien au contraire, sous la présidence Clinton, le budget de l’armée a quasiment doublé, de sorte que la puissance militaire américaine ne peut plus être rattrapée par personne. La troisième et dernière étape vers ce que certains appellent l’« hyperpuissance » a été franchie au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Jusque-là, les Etats-Unis pouvaient s’imaginer que leur seule supériorité militaire suffisait pour inspirer le respect et que personne n’aurait le courage de les attaquer. Ils n’avaient pas vraiment pris en compte le danger que représentent les terroristes individuels prêts à se sacrifier: ayant renoncé à leur propre vie, ils n’ont plus rien à perdre et ne redoutent aucune riposte. Cette découverte de leur vulnérabilité a amené les Etats-Unis à ajouter un nouveau chapitre à leur stratégie militaire, celui de la « guerre préventive », seule capable à leurs yeux d’empêcher les attentats terroristes. La guerre en Irak est l’effet direct de cette décision. La nouvelle doctrine a été codifiée par le document The National Security du 20 septembre 2002, qui affirme que, même si le temps et le lieu de la future attaque ennemie sont incertains, les Etats-Unis sont dans leur droit en frappant ces ennemis potentiels, terroristes ou Etats favorables au terrorisme anti-américain. L’introduction de cette notion, la guerre préventive, est une véritable innovation dans la vie internationale moderne : même si les grandes puissances ne se sont jamais abstenues d’intervenir dans les affaires des petits Etats, elles n’avaient jamais érigé en principe la décision unilatérale de déclencher la guerre à cause d’une attaque seulement possible. Le sénateur américain Robert Byrd avait donc raison de parler à ce propos d’un « virage dans la politique extérieure des Etats-Unis », d’une « approche radicalement nouvelle de l’idée d’autodéfense » et d’une « doctrine révolutionnaire de la prévention » (discours au Sénat américain du 12 février 2003). On pourrait trouver immorale une politique fondée sur la seule supériorité de puissance. Mais les jugements moraux n’ont pas leur place ici. La politique ne se confond pas avec la morale, et doit être jugée à l’aune de ses propres critères. La vraie question que doit se poser le gouvernement américain est : la poursuite de l’hégémonie mondiale à l’aide de guerres préventives est-elle le meilleur moyen pour assurer notre sécurité et défendre notre intérêt ? La paix par l’empire établit-elle l’ordre international le plus stable qui soit, et le plus favorable aux Etats-Unis ? L’intervention armée contre l’Irak en 2003, premier grand exemple de cette stratégie, permet d’observer la conséquence de la guerre en dehors des cabinets d’experts, dans le monde réel : il n’est pas prudent, en effet, de louer ou de condamner une doctrine à partir de résultats seulement escomptés. Cette guerre aura-t-elle apporté les effets voulus ? L’objectif déclaré, on l’a vu, était le renversement de la dictature et l’établissement de la démocratie. La première partie du programme a été accomplie avec célérité à la joie des émigrés politiques irakiens et d’une bonne partie de la population de ce pays. La seconde partie était plus complexe. Il faut dire que ce projet avait, dès le départ, quelque chose de naïf, puisqu’il considérait la société irakienne comme un ensemble non ordonné, où il est loisible d’introduire un nouveau régime politique à la manière d’un produit commercial. Or il n’est pas nécessaire d’être un sociologue professionnel pour savoir que les régimes politiques ne peuvent être isolés du reste de la structure sociale. La société forme un tout, aux éléments interdépendants. Les effets d’une mesure nouvelle ne dépendent pas seulement des qualités intrinsèques de celle-ci. Si l’on introduit la seule protection médicale sans toucher à rien d’autre, le résultat est une brusque montée de la natalité qui, à son tour, provoque exode rural et tensions sociales. Si l’on ouvre la frontière aux produits manufacturés, on détruit l’économie de subsistance locale et on favorise le glissement de la pauvreté à la misère. Si l’on plaque les règles démocratiques sur une société traditionnelle, on ne peut être sûr du résultat. Les avantages de chaque régime sont solidaires de ses inconvénients ; son introduction mécanique risque de favoriser ceux-ci au détriment de ceux-là. On a pu l’observer en 2001 en Afghanistan et en 2003 en Irak. Le régime des talibans méritait réprobation, mais son renversement n’a pas abouti à la création d’une démocratie à l’américaine, et il ne pouvait pas le faire : faisaient défaut les autres ingrédients d’une société libérale. Dans une grande partie du pays, le pouvoir est passé des mains des talibans à celles des chefs de guerre locaux ; il n’est pas certain que la vie quotidienne des Afghans, et même des Afghans, se soit améliorée. En Irak, le renversement de la dictature a laissé un vide de pouvoir, que ne pouvait combler l’armée victorieuse américaine. Il s’est ensuivi une période d’insécurité et de pillages qui a encore aggravé la situation de la population. Cet enchaînement n’a rien de surprenant : on sait qu’existe quelque chose de pire qu’un mauvais Etat, c’est l’absence de tout Etat. L’anarchie est pire que la tyrannie car elle remplace l’arbitraire de l’un par l’arbitraire de tous. De plus, à supposer qu’un gouvernement démocratique finisse par s’installer, rien ne garantit qu’il sera d’inspiration libérale, ni qu’il protégera les libertés de tous les individus. Que le pouvoir soit entre les mains du peuple ne garantit nullement qu’il sera bon : le « peuple» peut aussi décider, par exemple, que les femmes restent enfermées à la maison, ou que la peine de mort et les punitions physiques soient appliquées sans retenue. Une république islamique peut être imposée par la volonté du peuple : démocratique en ce sens, elle n’aurait pourtant pas contribué au bien-être de toute la population. L’exemple du Kosovo, qu’on évoque souvent dans ce contexte, n’est pas non plus très convaincant. Le but de l’intervention était d’empêcher la purification ethnique (le génocide annoncé était un moyen de propagande, non une menace réelle) – l’intervention a eu pour effet son instauration définitive, tous les Serbes d’un côté, tous les Albanais de l’autre, aucun des deux groupes n’osant s’aventurer chez le voisin. Le but était de bâtir la démocratie au lieu de la tyrannie ; elle a contribué à mettre en place un territoire géré par diverses mafias, plaque tournante de la prostitution et du trafic de drogue en Europe. « En l’absence d’ordre public, en l’absence de police et de tribunaux, le Kosovo est devenu un terrain idéal pour les crimes en tous genres », écrit le journaliste komsomol Veton Surroi. (Courrier international, le 25 avril 2003.) Le chômage y atteint 90% ; la province vit de subventions, principalement européennes. Les persécutions des albanophones par le pouvoir yougoslave central ont cessé, et c’est un bien incontestable ; mais la transformation de la province en protectorat de l’ONU, dépendant du financement international, constitue-t-elle vraiment un modèle de règlement pour les tensions interethniques ?
- Accueil
- Actualité
- Politique
- Société
- Economie
- Culture
- Sports
- Faits-Divers
- Lifestyle
- Auto
- Emploi
- Médias
Copyright © 2022 Aujourd'hui le maroc Conception et développement SG2I Consulting

© D.R
Articles similaires
EconomieSpécialUne
Dessalement de l’eau de mer à des fins agricoles : Le chantier en marche
Le dessalement de l’eau de mer permettra de libérer les ressources aux...
ParKawtar Tali22 avril 2024
SpécialUne
Les dernières pluies sauvent la mise
Le stress hydrique auquel le Royaume est exposé ces dernières années a...
Paralm22 avril 2024
ActualitéSpécialUne
Tout savoir sur les mesures prises au titre de la campagne 2023-2024
Les mesures prises s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour la...
Paralm22 avril 2024