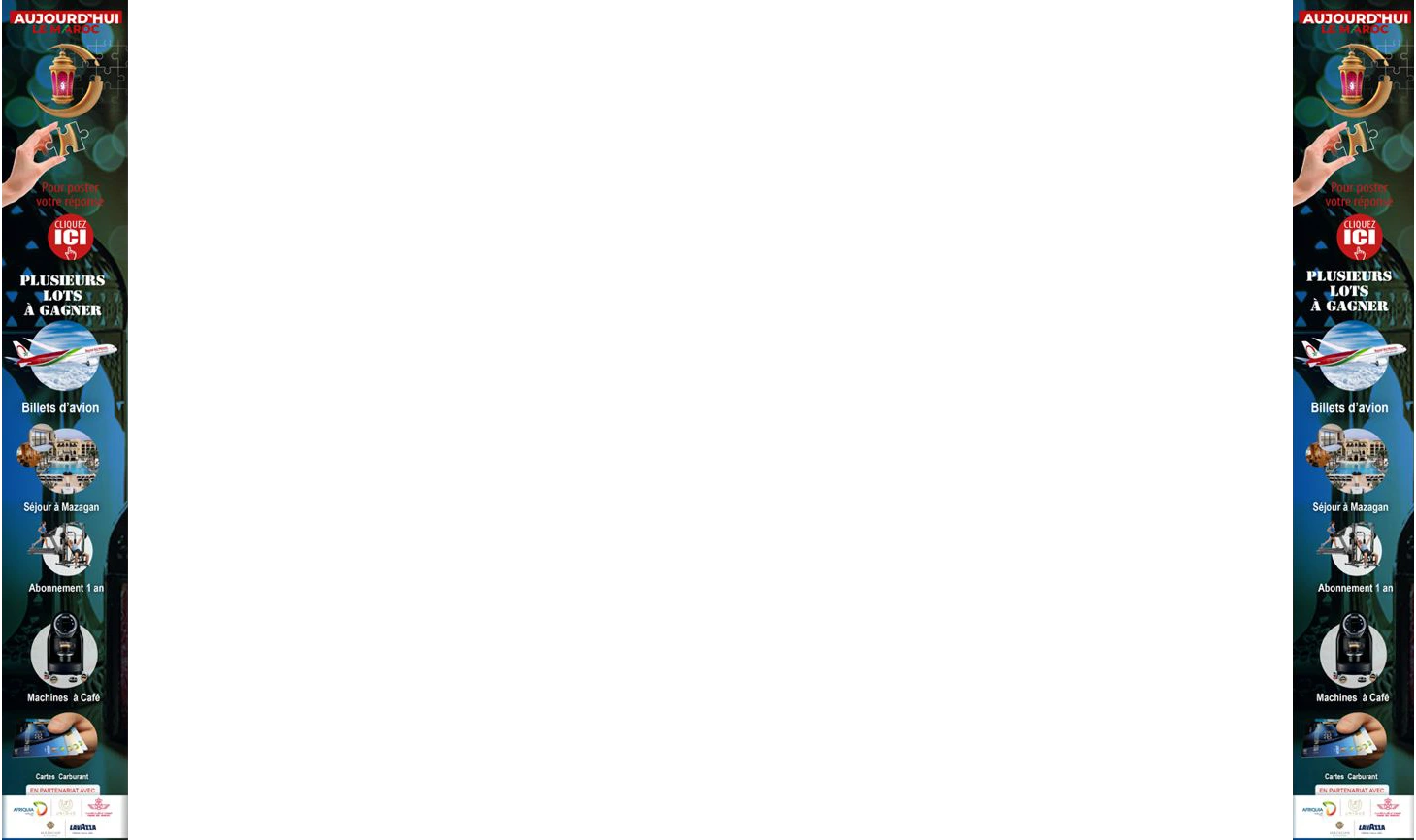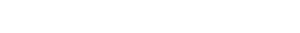Aujourd’hui le Maroc : Comment s’est produit le crash suite auquel vous avez été fait prisonnier pendant 25 ans ?
Ali Najab : J’effectuais une mission de reconnaissance à vue. En compagnie d’un autre avion de chasse, nous patrouillons à deux en vue de trouver l’ennemi, et éventuellement le détruire. C’était des missions courantes à l’époque. On faisait ces missions à bord des avions de chasse F5 et nous volions à très basse altitude : 30 à 50 mètres au-dessus du sol. J’avais terminé ma mission de reconnaissance et pensais atterrir à Smara, quand soudain mon réacteur droit a pris feu. J’ai immédiatement entrepris les mesures d’usage pour l’éteindre. Je n’avais pas fini quand le clignotant du réacteur gauche s’est également allumé ! Ce qui a dû vraisemblablement se produire, c’est qu’un premier réacteur a pris feu accidentellement. Ensuite, un missile a été envoyé et il est venu droit sur l’avion, parce que le réacteur en feu constituait une source de chaleur très importante qui l’a aisément guidé jusqu’à l’avion. A l’époque, nos avions n’étaient pas équipés d’anti-missiles. Les deux réacteurs en feu : le F 5 n’était plus contrôlable. Il fallait que je m’éjecte, dans l’espoir d’être récupéré par les unités des Forces armées royales qui étaient dans les parages.
Que s’est-il passé quand vous avez atteint le sol ?
Je ne me suis pas éjecté tout de suite. Je m’en souviens encore comme si c’était hier, pourtant le crash remonte au 10 septembre 1978. Mon coéquipier me suppliait de m’éjecter. Je ne l’ai pas écouté tout de suite, dans l’espoir de planer. Mais c’était impossible avec l’ampleur que prenait le feu et la menace imminente de l’explosion du F 5. Je me suis éjecté, comptant sur l’autre avion qui allait prévenir nos unités. Quand j’ai atteint le sol, je me suis débarrassé de mon parachute et ai couru pendant 35 mn vers l’unité marocaine la plus proche, qui se trouvait à 10 km de l’endroit où j’ai sauté. Malheureusement, le polisario est arrivé plus vite. Trois Land-Rover ont suivi ma trace et m’ont rattrapé. C’était presque au coucher de soleil, et j’ignorais qu’il coïncidait avec le crépuscule de ma vie.
Et après votre capture…
Je vous fais grâce de toutes les insultes et coups que j’ai reçus. J’ai été roué de coups pendant tout le trajet. J’ai perdu connaissance et ai repris mes esprits vers 4 heures du matin. Là, les polisariens m’ont conduit chez Lahbib Ayoub, celui-là même qui est rentré au pays il y a quelques mois. Quand je suis arrivé chez lui, il a demandé que l’on arrête de me taper dessus. Après, j’ai été amené à Tindouf où un capitaine et deux lieutenants algériens sont venus m’interroger. Et c’est là que j’ai passé mon enquête.
Donc, ce sont des Algériens qui ont mené l’enquête ?
Mais ce sont les Algériens qui ont mené l’enquête avec tous les officiers marocains, prisonniers du polisario. D’ailleurs, il n’y a aucun mystère là-dessus. Moi, je ne parle pas de polisario, mais d’Algérisario. Tous les prisonniers le savent, ce sont les Algériens qui contrôlent tout à Tindouf. D’ailleurs, les officiers marocains, capturés par le polisario, étaient auparavant conduite à Blida, à l’extrême nord de l’Algérie. Cette ville se situe à deux pas d’Alger. C’est bien des années plus tard que ces prisonniers ont été acheminés vers Tindouf.
Dans quelles conditions s’est déroulée l’enquête ?
Aucun effort n’a été ménagé pour me rendre la vie insupportable. Je dormais dans une cave avec les menottes aux pieds et aux mains. Pendant tout mon séjour à Tindouf, c’est-à-dire à peu près les deux mois de l’enquête, je dormais chaque soir avec les mains et les pieds liés. Les menottes avaient entamé la peau et la chair. Et je craignais que mes plaies ne se gangrènent.
Et après…
On m’a conduit dans une enceinte où des prisonniers étaient entassés pêle-mêle dans des trous. Il n’y avait pas de couvertures. Et je préfère ne pas décrire les conditions d’hygiène. Je me souviens d’une journée particulièrement atroce. Il avait plu abondamment et l’eau a inondé les trous qui nous servaient d’abris. Nous avons passé une nuit avec de l’eau jusqu’aux genoux. Le lendemain, j’ai crié comme un fou pour demander au frère du soi-disant ministre de la défense de nous sortir de ces trous, le temps qu’ils sèchent.
Pourtant, la presse et quelques délégations étrangères qui rendaient visite aux prisonniers marocains dans les camps de Tindouf ne rapportaient pas ces conditions…
Mais, bien sûr ! On nous donnait alors une lame de rasoir. Une lame pour dix personnes ! On nous demandait aussi de porter les habits avec lesquels nous avons été capturés. Quand nos treillis devenaient trop déchirés ou trop sales, on nous donnait des uniformes kakis…
Après la visite des journalistes ou d’une délégation, on nous obligeait de les enlever pour porter de nouveau nos haillons. Autre chose : le polisario ne nous présentait pas à tout le monde, mais aux gens qui
Vous souvenez-vous d’une rencontre marquante avec un journaliste ou un diplomate?
Un jour, un sénateur américain et pas des moindres, Steven Solar, m’avait pris à part. Il m’a posé une question sur le grand nombre de prisonniers (2500 prisonniers dont 513 sont encore en détention dans le désert, ndlr). Pourquoi tant de prisonniers ? J’ai répondu : quand les Etats-Unis donnent au Maroc une arme d’une portée de 400 mètres, les Algériens et les Soviétiques procuraient au polisario une arme d’une portée de 800 m. C’est comme si vous boxiez contre un adversaire qui a les bras deux fois plus longs que vous. Vous avez beau être déterminé et lui porter des coups qui font mal, vous ne pouvez pas éviter d’en recevoir.
Lors des visites de ces délégations, le polisario ordonnait aux prisonniers de faire de faux témoignages. Qu’advenait-il d’eux quand ils désobéissaient ?
Un jour, le polisario m’a ordonné de donner une lecture du livre intitulé le «Commandeur des croyants» de John Waterbury. Mon commentaire devait être diffusé à la radio.
En fait, ils m’ont remis une feuille où toute mon intervention était écrite. Je n’étais évidemment pas d’accord avec le discours propagandiste sur le soi-disant mauvais traitement que faisaient subir le Roi et les partis politiques au peuple marocain. Je leur ai jeté leur papier à la figure. Et j’ai été torturé pendant 48 heures.
Qu’est-ce qu’ils utilisaient comme moyen de torture ?
On m’a fouetté avec un câble électrique. Le dos et les jambes étaient intensément fouettés. Et comme le fouet n’était pas assez acide au goût de mes tortionnaires, ils m’ont obligé à transporter une brique de 15 kg. Avec cette charge, il fallait faire des allers-retours sur 200 mètres au mois d’août sous un soleil brûlant. Il fallait de surcroît effectuer le trajet pieds nus. Au bout de 48 heures, des ampoules avaient poussé sur mes pieds. Elles étaient aussi grosses que des abricots. Je ne pouvais plus marcher ! Ils m’ont alors jeté dans une cellule en me disant : «Quand tu seras rétabli, on recommencera.
Ont-ils recommencé ?
Au bout d’un mois, ils n’ont pas recommencé. Mais je n’ai pas été maté pour autant. George Habache, le révolutionnaire palestinien, est venu un jour nous cracher sa haine. Ses insultes m’ont mis hors de moi et je lui ai envoyé une giclée sur la gueule. Et rebelote la torture.
Receviez-vous des informations du pays?
Oui, j’avais un échange épistolaire avec ma femme. Au début, surtout par l’intermédiaire de journalistes. Ensuite par le truchement de la Croix-Rouge qui est venue nous voir trois ans après le cesser-le-feu en 1991. J’ai commencé alors à écrire des lettres et en recevoir.
Un quart de siècle en prison, c’est long. Comment remplissiez-vous votre quotidien? Qu’avez-vous fait de vos journées pendant toute cette période ?
Je passais mes journées à espérer! Les prisonniers et les sous-officiers travaillaient. Ils faisaient toutes les corvées : bâtir, creuser des puits, charger et décharger les denrées. Les officiers ont eu droit à un meilleur traitement, après avoir fait, eux aussi, les corvées pendant trois ans. Ils ont arrêté, et je pense que la Croix-Rouge a été pour quelque chose dans la décision de les considérer comme des prisonniers de guerre. Malheureusement, les soldats n’ont pas eu cette chance. Ils n’ont jamais cessé de travailler. Ils n’ont pas eu un seul jour de repos. J’ai calculé le nombre de jours où ils ont travaillé. Au total : 9125 jours, sans une seule journée de répit. Ils s’activent depuis l’aube jusqu’au coucher de soleil. Et encore ! quand le polisario avait besoin d’eux, il les réveillait la nuit pour d’autres corvées. Ils ont construit Lahmada sous le fouet. Je peux témoigner qu’aucun soldat n’a été volontaire pour construire quoi que ce soit. Ils ont travaillé avec les fouets qui sifflaient plus fort à leurs oreilles que les vents de la région.
A propos de mauvais traitements, avez-vous fait partie des prisonniers interrogés par les rédacteurs du rapport de l’association France-Libertés, publié en septembre 2003?
Oui, j’ai parlé pendant 45 mn avec une personne de France-Libertés. Elle a interrogé, je crois, 700 prisonniers. Quand elle a fait le recoupement, elle a rédigé son rapport. J’ai lu ce rapport ! Il correspond à la réalité du vécu des prisonniers. Nous avons pris le risque de lui parler à coeur ouvert, parce que nous étions lassés par l’indifférence du monde à notre souffrance. Parce que la propagande du polisario faisait un écran qui voilait à tous les sévices que nous subissions. Et ceux qui connaissaient cette vérité n’en parlaient pas. A commencer par notre pays, le Maroc.
Pourquoi le Maroc a mis beaucoup de temps avant de parler des prisonniers ?
Je ne sais pas. C’était peut-être un sujet tabou. Il y avait bien des prisonniers qui ont réussi à s’évader et qui ont été libérés, mais on ne communiquait pas ces données à la presse. C’était le silence total. D’ailleurs, ce n’est pas le seul motif de doléance qu’on peut avoir à l’égard de notre pays. Ma famille percevait ma solde, les indemnités du Sud en moins. C’est tout ! Il n’y a pas eu d’avancement et après notre libération le 1er septembre 2003, nous avons été reçus à Agadir d’une manière glaciale.
Vous avez l’impression que le pays a un peu honte de vous, qu’il vous considère comme une face peu glorieuse de son Histoire ?
Je ne vous cache pas que j’ai été extrêmement déçu. Jamais je n’ai pensé qu’après tout ce que j’ai donné à mon pays, il allait m’accueillir comme si j’avais une tare honteuse. Je n’ai jamais pensé qu’après tant de dévouement pour mon pays, et c’est un devoir !, ce pays allait me le rendre par de l’ingratitude. Un très haut gradé aurait dit qu’on ne peut pas avancer des gens qui se sont livrés à l’ennemi sans combattre. S’il a vraiment dit cela, c’est extrêmement grave. Parce que les gens qui sont tombés entre les mains de l’ennemi ne se sont pas livrés de leur gré, ni même pas parce qu’ils n’ont pas voulu combattre. Mais parce qu’on les a laissés seuls sur le terrain. Comment une personne peut se rendre aisément à l’ennemi quand elle sait qu’elle risque le pire en se livrant ? J’ai parlé aux soldats qui ont été libérés, leur amertume est indescriptible. Et dire que là-bas, nous sommes restés des officiers dignes.
Vous demandez de la reconnaissance ?
Je vous assure que je ne suis pas encore remis du choc. Il y a en moi une partie anéantie. Comment voulez-vous que les générations futures puissent se dévouer à la nation quand elles constateront l’ingratitude dont nous faisons l’objet ? La nation a un droit de mémoire vis-à-vis des personnes qui se sont sacrifiées pour elle. Je ne sais pas ! Je ne sais plus ! Je ne comprends pas ! En plus, beaucoup de soldats sont morts. Pourquoi ne pas honorer leur mémoire? Saluer leur héroïsme ? C’est à croire que nous refusons d’avoir une mémoire. Les vingt-cinq années de ma vie passées en capture ne m’ont pas fait autant mal que l’après-prison.
Qu’est-ce qui vous a permis de garder de l’espoir pendant toutes ces années ?
Sans ma femme, je n’aurais pas tenu autant. C’est en elle que je trouvais la force et l’énergie pour ne pas succomber au désespoir. J’ai tenu bon, dans l’espoir de la revoir. C’est grâce à ses lettres au début, à son combat pour que l’on ne m’oublie pas, et vers la fin à ses colis et à ses médicaments que j’ai trouvé la force de résister. Le fait de savoir qu’elle s’est occupée de notre fille m’a réconforté. Je n’avais pas tout perdu. Je voudrais aussi souligner l’aide de ma famille, particulièrement mon frère et mon beau-frère, Ahmed El Biaz, qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour soutenir ma petite famille.
Avez-vous gardé des liens avec la famille des chasseurs ?
Bien sûr ! Je voudrais à ce sujet rendre hommage à mes camarades de la deuxième BAFRA, surtout les chasseurs, pour l’accueil qu’ils m’ont réservé, en tant qu’ancien pilote de cette base. Je les remercie vivement de cet hommage. Leur accueil m’a réchauffé le coeur. Ils m’ont permis aussi de réaliser un rêve. A mon retour, j’ai demandé à effectuer une mission pour ne pas quitter ce métier et l’armée de l’air sur une fausse note. On a accepté et j’ai été faire une heure de vol en double-commande sur un F5 F. J’ai survolé le Maroc pour imprimer les images du pays dans ma mémoire et pour garder un bon souvenir de cette armée de l’air que j’aime beaucoup.
- Accueil
- Actualité
- Politique
- Société
- Economie
- Culture
- Sports
- Faits-Divers
- Lifestyle
- Auto
- Emploi
- Médias
Copyright © 2022 Aujourd'hui le maroc Conception et développement SG2I Consulting
Chroniques
Les grandes interviews de ALM : Un pilote qui revient de loin
ALM7 mai 20049 MINS LECTURE596 Vues

© D.R
Articles similaires
Chroniques
Le Polisario, un poison africain
Que ce soit sur le plan diplomatique ou sportif, le Polisario pose...
ParMustapha Tossa26 avril 2024
AutreChroniques
Santé mentale et pouvoir d’achat
Il nous faut faire de la santé mentale des Marocains une priorité...
ParImane Kendili25 avril 2024
Chroniques
Chère prise de parole en public
Pour prétendre à te prendre en public, toi chère prise de parole...
ParSophia El Khensae Bentamy24 avril 2024
Chroniques
Une véritable transformation et évidence du paysage socio-économique
Le rôle incontournable de la femme ingénieure au Maroc
ParALM23 avril 2024