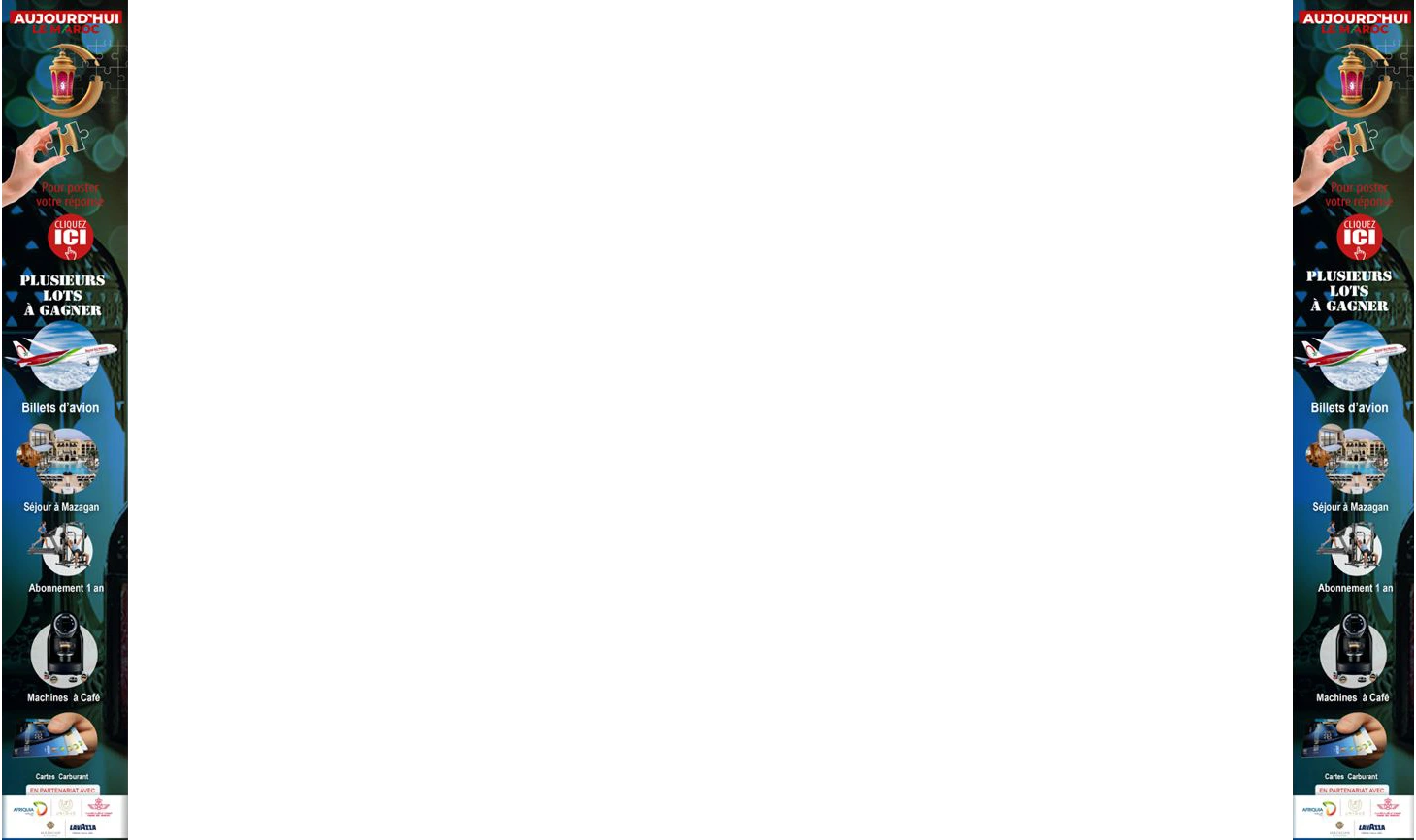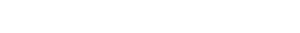Aucun homme véritable, aucun individu travaillant sur le projet de sa liberté, qui est constamment en devenir, ne peut vivre sans un but qu’il s’efforce d’atteindre.
C’est une réalité inaliénable, depuis l’aube des cultures humaines, toute société, pour se maintenir et vivre, a besoin absolument de respecter quelqu’un et quelque chose. Comment faire quand nous avons dépassé le stade de la déshérence pour donner corps à une pseudo humanité où l’on ne respecte ni l’individu ni la société où il doit déployer sa vie ?
D’abord, il faut comprendre que chacun de nous est responsable de tout devant tous. Ensuite veiller à ce que cette forme de folie ambiante qui a envahi le monde, dans ses différentes variétés et strates, ne devienne pas la règle qui régit la totalité des aspects de la vie : cette folie qui met dans le même panier tous les délirants au nom des dogmes, tous les asphyxiés de la vie, tous les maniaques au nom d’un credo inexistant et mensonger.
C’est là le grand danger qui vient achever le chaos humain où plus aucun individu ne peut plus prospérer et respirer : «Je ne suis guère touché d’entendre dire qu’un homme, que je tiens pour fou ou pour un sot, surpasse un homme ordinaire en de nombreuses occasions ou affaires de l’existence. Les épileptiques, en pleine crise, sont d’une force extrême ; les paranoïaques raisonnent comme peu d’hommes normaux savent le faire ; les maniaques atteints de délire religieux rassemblent des foules de croyants comme peu de démagogues (si même il en est) réussissent à le faire, et avec une force intérieure que ceux-ci ne parviennent pas à communiquer à leurs partisans. Et tout cela prouve seulement que la folie est la folie. Je préfère la défaite, qui reconnaît la beauté des fleurs, à la victoire au milieu du désert», écrivait l’auteur de «Le livre de l’intranquilité», Fernando Pessoa.
Ce désert est aujourd’hui rempli de ferraille et de béton. C’ est une prison à ciel ouvert. Personne ne peut en réchapper. C’est une forteresse imprenable. Ce désert fait monter des murailles autour de chacun de nous, le tenant prisonnier d’un point de vue unique sur son monde qu’il ne peut plus remodeler à sa guise. Il le confine à l’immobilité dans la fausse croyance qu’il agit, alors qu’il ne fait que subir et réagir en conséquence dans la droite ligne de ce qu’on lui dicte et de ce qu’on attend de lui.
Comment alors pouvoir te construire toi-même pour te surprendre étant convaincu que l’important dans cette vie, dans ce passage qu’est l’existence au monde, n’est pas d’être, mais de devenir qui l’on est profondément. Sans oublier que cette lutte de tous les instants engendre une grande forme de souffrance, née de la confrontation, du combat de celui qui refuse d’abdiquer et de se vendre. Celui-ci sait que sa douleur doit le relever au lieu de l’avilir. C’est dans ce sens que la souffrance et la douleur sont toujours indispensables pour une conscience large et pour un cœur profond. Les hommes qui sont vraiment grands doivent ressentir dans le monde une grande tristesse qui n’est pas la négation du bonheur, celui-ci n’étant jamais installé dans la durée plate, mais incarné en instants de fulgurances joyeuses.
C’est ainsi qu’aucun homme véritable, aucun individu travaillant sur le projet de sa liberté, qui est constamment en devenir, ne peut vivre sans un but qu’il s’efforce d’atteindre. Cet objectif lui sert de lanterne qui luit toujours plus loin, éclairant un sentier unique pour un homme seul. Cet homme sait que s’il n’a plus ni but ni espoir, sa détresse fait de lui un monstre comme tous les estropiés de la cité qui vivent selon le diktat des États qui leur ôtent tout but et tout objectif, en dehors de celui de consommer et de s’amuser, dans la consécration de la superficialité la plus criante, du factice traître et de l’ignorance crade. «Laissez-nous seuls, sans les livres, et nous serons perdus, abandonnés, nous ne saurons pas à quoi nous accrocher, à quoi nous retenir; quoi aimer, quoi haïr, quoi respecter, quoi mépriser?», avait écrit Fiodor Dostoïevski mettant le doigt sur le rôle unique et crucial de la connaissance et du savoir pour faire société avec des individus solides, libres, connaissant et assoiffés d’en savoir toujours plus.
On devrait suivre ici le conseil de l’auteur du Procès, Franz Kafka, qui nous dit la chose suivante : «On ne devrait lire que des livres qui nous piquent et nous mordent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d’un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire? Un livre doit être la hache qui brise en nous la mer gelée», avant d’ajouter que «Nous avons besoin de livres qui agissent sur nous comme un malheur dont nous souffririons beaucoup, comme la mort de quelqu’un que nous aimerions plus que nous-mêmes, comme si nous étions proscrits, condamnés à vivre dans des forêts loin de tous les hommes, comme un suicide». C’est là l’allié indestructible qui peut accompagner l’homme sur le chemin de sa liberté revendiquée.